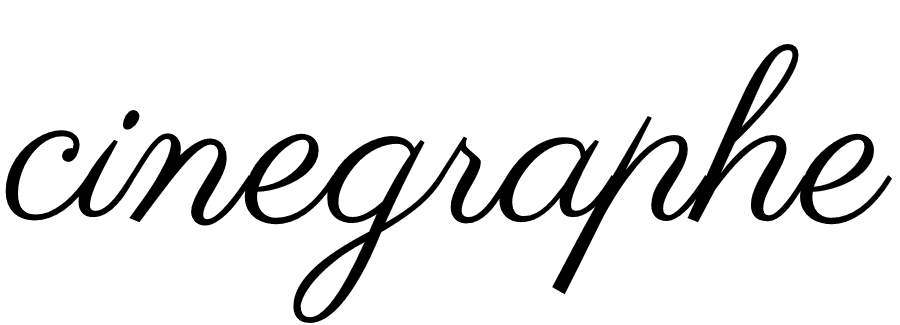Au milieu des années 1950, Jean-Luc Godard tourne Une femme coquette, un court-métrage d’une dizaine de minutes, adapté d’une nouvelle de Guy de Maupassant, Le Signe. C’est son deuxième film, après Opération béton et avant Une Histoire d’eau, qu’il réalisera avec François Truffaut.
Armé d’une caméra 16 millimètres, Godard situe l’action à Genève, et suit les déboires d’une jeune femme mariée, Agnès, qui, pour s’amuser, joue à la prostituée. Seulement, les conséquences sont désastreuses, et la voici prise à son propre piège, tout cela à cause d’un simple sourire, comme le signe d’une invitation au plaisir. Elle écrit une lettre à son amie, lui narrant ses mésaventures.
Le dispositif filmique se fait sur deux niveaux : un premier, situé dans le présent et qui ouvre le film, sert à la fois de portrait du personnage-narrateur et annonce le second, au passé, à savoir celui de l’histoire d’une terrible mésaventure. La jeune femme est chez elle, la voix-off accompagne l’écriture de la lettre, et invite progressivement le spectateur à suivre son récit.
Le montage et la narration rétrospective à la première-personne permettent ainsi de faire du questionnement moral le propos principal du film. Agnès cherche un soutien émotionnel auprès de son amie, elle tente de lui prouver son innocence, en insistant sur ses intentions, qui n’étaient pas mauvaises, plutôt que sur les conséquences de son acte. Elle lui écrit finalement comme pour se prouver elle-même que les conséquences ne sont peut-être pas si graves, et qu’elle a été victime d’une fatalité qui la transformerait presque en héroïne de tragédie : « mais que pouvais-je faire ? », dit-elle. Il s’agit donc, pour le spectateur, de se mettre dans la peau du destinataire de la lettre, et ainsi de se faire juge des agissements du personnage.
La musique de Bach vient rythmer la narration et ajoute à l’histoire un sentiment tragique, renforçant ainsi l’idée d’un enchaînement inéluctable auquel elle a été confrontée. Godard joue ainsi avec les ressources du cinéma, et se fait très cruel envers son personnage, dont le spectateur peut parfois bien se moquer. Lorsqu’elle commence à narrer sa mésaventure, Agnès parle de banalités, de la météo, comme pour ménager son lecteur et l’amener en douceur à la faute qu’elle a commise.
Cette faute a été guidée à la fois par sa curiosité et son désir, celui de plaire et de voir qu’elle plait. En voyant la prostituée penchée à sa fenêtre, faisant des sourires aux passants, elle est elle-même intriguée par ce spectacle. Ses allées et venues dans les rues de Genève illustrent ses élucubrations, elle ne parvient pas à se décider. Serait-il vraiment mal de sourire à un inconnu, de voir si la séduction est efficace ? « Les femmes croient innocent tout ce qu’elles osent », dit-elle, pleine de cruauté envers son sexe. Finalement, elle cède à la tentation, sourit à un homme, non sans avoir longuement hésité, et le voici qui la poursuit en voiture comme pour récupérer son dû. Le passage à l’acte ne sera pas montré, mais seulement suggéré par Agnès en voix-off.
Ses jugements moraux la laissent indécise, et il lui est difficile d’assumer son désir, qui oscille entre curiosité, plaisir et culpabilité. L’excitation liée à l’inconnu, à l’interdit et au caché lui fait aimer le danger, mais la conduit finalement à perdre le contrôle. Le film rend ainsi compte de ce questionnement moral, notamment grâce au montage.

Les images viennent illustrer les propos de la lettre qui est lue en voix-off par la jeune femme. La caméra, observatrice, se tient souvent à distance du personnage. La marche d’Agnès à travers la ville est un prétexte à la flânerie, mais sert aussi un parti pris esthétique et technique, à savoir celui de filmer la rue, d’être au plus près de la réalité. Les points de vue s’échangent, entre celui d’Agnès qui voit la femme à sa fenêtre, la femme qui aguiche les hommes, et l’homme, en bas, interprété par Godard lui-même.
Il est possible de voir cette furtive apparition du réalisateur dans son film comme une manière d’y apposer sa signature. Godard utilise au générique un pseudonyme, Hans Lucas, nom qu’il utilisait parfois en tant que critique.
Une Femme coquette révèle déjà les nouveaux usages de la technique cinématographique que les réalisateurs de la Nouvelle Vague développeront pleinement à la fin des années 1950, portés par des aspirations esthétiques singulières.