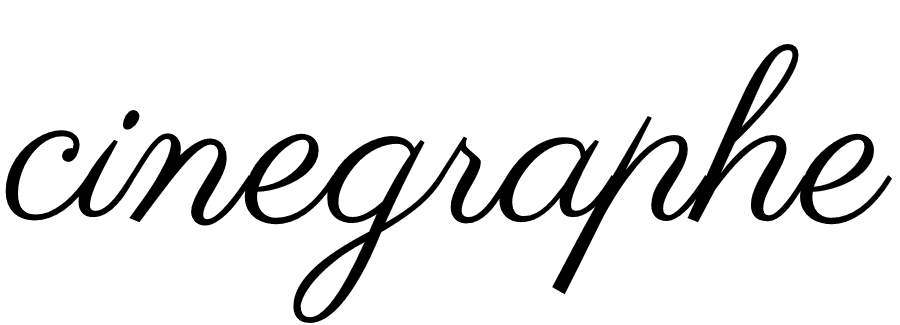Ils éprouvaient les effets de la délicieuse harmonie entre nature et architecture, entre corps et décor.
Pomme, jeune parisienne révoltée et ambitieuse, qui lutte pour les droits des femmes dans la société française des années 70, rencontre un jour Darius, bel iranien ténébreux, qui l’emmène vivre les Mille et une nuits dans son pays. Le court métrage Plaisirs d’Amour en Iran se présente comme un petit complément, comme une pause documentaire et sensuelle, au long-métrage L’une chante, l’autre pas, tourné par Agnès Varda en 1976. Il peut bien sûr être vu indépendamment de ce dernier.
Dans les années 1970, l’Iran s’ouvre à la modernité et à l’Occident. La réalisatrice, armée de sa caméra, vient y saisir la beauté sacrée des édifices religieux. La voix-off, celle de Thérèse Liotard, qui interprète le personnage de Suzanne, grande amie de Pomme, dans L’une chante, l’autre pas, révèle toute la sensualité et l’érotisme de l’architecture environnante.
Ce ne sont donc plus des dômes et des toits qui recouvrent les bâtiments chauds et colorés d’Ispahan, mais des seins, galbés et dorés. L’architecture se fait corps, le corps se fait architecture. Les deux sont voluptueux, désirables, beaux. L’érotisme du discours en voix-off vient ainsi donner à l’image une toute autre dimension. Les murs décorés, les mosaïques hautes en couleur, les piliers majestueux des mosquées sont comme les parties d’un corps que la caméra scrute, dans les moindres détails, sans jamais le révéler en entier. Le spectateur est comme invité à contempler, dans son imaginaire, un corps nu, dont le dévoilement se fait par touches. Filmer des morceaux pour rendre compte d’un ensemble, révéler sans montrer, là est tout l’art de la suggestion.

Le discours des amants s’ajoute ensuite aux images. Le spectateur les devine, nus, amoureux. Il entre dans leur intimité, mais ne peut les voir. Seules leurs voix, douces et légères, lui parviennent. L’érotisme des paroles se mêle à des propos plus crus et presque enfantins : « c’est ce bruit de jet d’eau (…), ça me donne envie de boire, et aussi de pissouiller », dit Pomme à Darius, alors qu’elle vient tout juste de vanter les mérites de son « Minaret ». Tout en montrant l’architecture du paysage, Agnès Varda fait deviner, par le discours de ses personnages, leurs corps, sans les présenter à l’écran.
C’est finalement au bout de deux minutes que la caméra les retrouve, au milieu d’un jardin persan, à l’ombre d’un olivier. Les amoureux parlent de poésie et d’amour. « Toutes les lignes de ton corps sont les arabesques de mon jardin imaginaire », récite Darius. L’adéquation entre corps et décor continue. Pomme, dans sa pose indolente, avec ses cheveux roux en pagaille et sa robe à fleurs qui laisse deviner ses jambes claires, apparaît comme un élément inhabituel de ce tableau idyllique. En arrière-plan, trois femmes, voilées, sont assises contre un mur, elles regardent et écoutent les amoureux. Chacune d’elle appartient à une génération différente.

Le point de vue de la caméra se resserre finalement sur Pomme et Darius, près de la fontaine. Les images des miniatures iraniennes viennent compléter le portrait du couple, qui prend des allures intemporelles et universelles. Les amoureux de la miniature ajoutent au film un aspect documentaire, qui se prolonge ensuite avec la présentation d’autres miniatures : celles d’hommes et de femmes. Il s’agit ici de faire une brève peinture de la société iranienne, des relations hommes-femmes, sans y apposer de jugements.
La forme hybride du court-métrage permet à la réalisatrice de jouer avec les codes cinématographiques. Documentaire, lyrisme et érotisme se mêlent dans cet espace immense qu’est le bleu de l’azur et des mosaïques. Les bassins sont à la fois les miroirs des bâtiments et des amants, comme reflets profanes de la sacralité du lieu et des sentiments. « C’est un lieu troublant pour des amoureux, même si ce sont les personnages d’un film ». Le quatrième mur est finalement brisé.
La rêverie amoureuse, audacieuse et malicieuse, se fait aussi comme hymne à la liberté des femmes. Pomme déambule dans le paysage persan. La caméra montre son corps, le dévoile, tout comme elle le fait avec l’architecture, pour en révéler la beauté. Aussi, la sensualité du paysage ne peut être totale sans la mise en scène du corps et de la voix.
L’image devient un support privilégié où se déploie le mouvement du corps, sa sensualité et son désir, toujours en relation avec l’espace qui l’environne. Agnès Varda parvient ainsi à concilier l’esthétique et l’érotique, sans que l’un ne prenne le dessus sur l’autre.