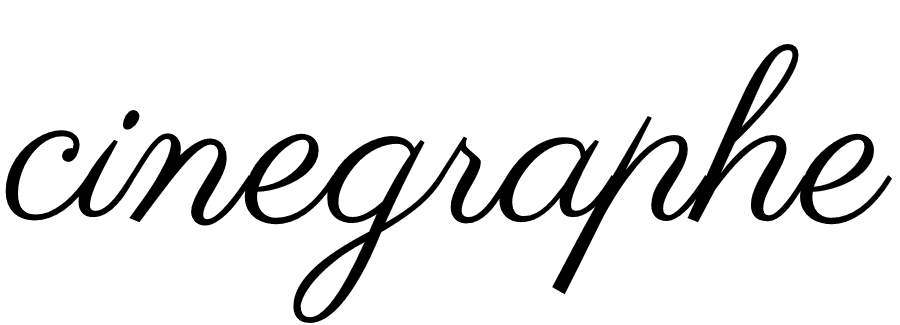Faire de la lenteur une attente poétique.
La Nouvelle Vague, en particulier en France et dans d’autres pays d’Europe, exerce à la fin des années 1960 une large influence dans le monde entier. C’est le cas au Japon, mais aussi en Inde, notamment avec les œuvres du cinéaste Mani Kaul.
En 1969, il tourne son premier long-métrage, Notre pain quotidien (Uski Roti), adapté d’une nouvelle de Mohan Rakesh. L’action se situe dans le milieu agricole du Pendjab, et l’histoire se veut très simple : Balo, épouse fidèle et attentionnée, prépare tous les jours le déjeuner de son mari, Sucha Singh, frivole chauffeur de bus, et le lui apporte.
Mani Kaul tourne avec des acteurs pas ou peu connus, sans trop de moyens, et fait du cinéma un art du temps. Le film s’oppose au cinéma narratif, et le discontinu, la rupture et l’immédiateté viennent travailler le présent et l’instant. Les portraits des femmes ajoutent une dimension documentaire : il s’agit, au-delà de la simple fiction, de rendre compte du travail de ces femmes dans les champs, de leurs activités manuelles et artisanales, dans des conditions très précaires. C’est en privilégiant les plans larges, une caméra fixe et des personnages éloignés de la caméra que Mani Kaul se place au plus près de la réalité sociale de son époque. Lorsque les personnages apparaissent à l’écran, c’est souvent avec peu de profondeur, et ils se situent toujours en retrait par rapport à la caméra, le regard en biais.
La façon de filmer, très épurée, révèle un goût particulier du détail : les visages, les yeux, mais surtout les mains. Plutôt que de rendre compte du corps en entier, Mani Kaul préfère la suggestion et n’en montre que des parties isolées. Le réalisateur se dit lui-même influencé par Robert Bresson, et comme lui, fait des mains un personnage autonome, à forte intensité dramatique, au silence pesant. Elles offrent leur propre narration, leur poésie singulière, pour finalement laisser l’image parler d’elle-même. Elle séduit par son attrait parfois bucolique et sensuel, dès les premières minutes du film, où la main est le seul acteur du drame et vient ramasser un fruit, presque comme un élément intrusif dans une nature morte.

S’ensuit ensuite une galerie de portraits, qui laisse parler des visages silencieux, usés par la fatigue et abîmés par le soleil. Ce sont ces personnages qui viendront rythmer le film, qui comporte très peu de dialogues, et se déroule sans drame. Le spectateur est alors invité à participer à l’attente, mais surtout à l’éprouver. Par ailleurs, le sujet décrit ici est lourd de sens et la réalité difficile, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et de vie des femmes, que Balo incarne. Elle doit non seulement faire face à son mari infidèle, mais aussi à la malveillance et la violence masculine qui règnent, et est confrontée à une pesante solitude.
L’image importe plus que la narration et le discours, elle devient une forme malléable et vivante, qui porte l’attention avant tout sur la façon dont les choses sont représentées, et non sur les choses elles-mêmes.
Plusieurs fois le spectateur peut se prendre à rêver devant ces images, perdre le fil de ces plans qui s’enchaînent parfois avec du retard, mettant toujours l’action en suspend. Le temps se décompose, il est étiré au maximum, dans une totale économie de la narration et des dialogues, et s’éloigne de tout développement réaliste.
Mani Kaul l’a lui-même dit, il souhaitait réaliser son film comme un peintre ferait une toile*. Le réalisateur indien travaille et modèle l’espace comme un tableau, qui révèle sa poésie muette, touche le sensible pour ensuite s’adresser à l’intellect.
*MacDonald, Scott (1998). A Critical Cinema 3: Interviews With Independent Filmmakers. University of California Press.