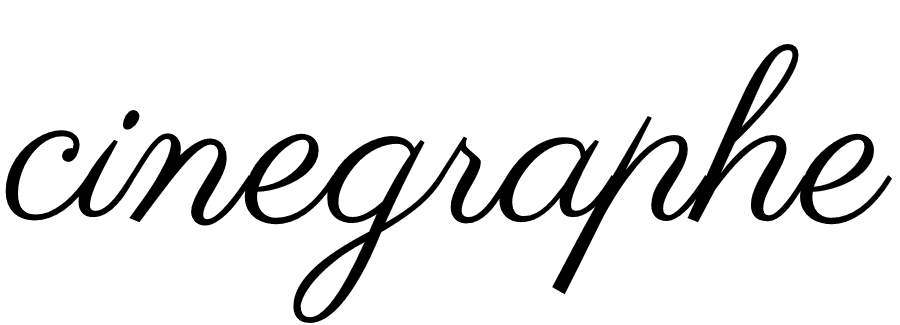De l’art de faire du vrai avec du neuf
L’espace chez Rohmer est traité comme bien plus qu’un simple décor. C’est un personnage à part entière, moderne et reflétant les aspirations utopiques de l’architecture contemporaine.
Sous ses airs de cité idéale, dont la symétrie lui confère un aspect gracieux et achevé rappelant le Panneau d’Urbino, la ville nouvelle de Cergy-Pontoise des années 1980 abrite en réalité des âmes tourmentées, amoureuses et vagabondes. Elles ne cessent de se croiser, de s’éloigner et de se retrouver.

en haut : L’Ami de mon amie, Léa et Blanche dans le quartier de St-Christophe
en bas : La Cité idéale, dit aussi « le panneau d’Urbino », 1472
Le cinéaste se fait le témoin d’une transformation urbaine achevée en montrant des fragments de ville révélateurs de cette utopie architecturale. La ville n’est pas un lieu étroit et oppressant, mais au contraire, elle fait naître la beauté paradoxale du béton, du fer et de l’acier. Elle donne à voir des gestes, des allures et des démarches.
Aussi le spectateur se plaît à suivre les allées et venues de Blanche (Emmanuelle Chaulet) entre la gare RER et son appartement dans le quartier Saint-Christophe. Il lui arrive de rencontrer par hasard Fabien (Eric Viellard), l’ami de son amie Léa (Sophie Renoir), ou Alexandre (François-Eric Gendron), autour duquel elle a construit une image idéale qui ne la laisse guère insensible. Au milieu d’un décor neuf, insolite et presque artificiel, l’intrigue se met en place.
Arrêtons-nous dans un premier temps sur le traitement de l’espace urbain, thème cher au réalisateur. On ne peut en effet s’empêcher de penser à son court-métrage documentaire Métamorphoses du Paysage : l’ère industrielle, de 1964. Il y présentait alors plusieurs facettes du paysage industriel, allant des villes du Nord et leurs bassins houillers évoquant certains poèmes de Verlaine (Romance sans paroles, 1874), jusqu’aux ponts du Canal Saint-Martin à Paris et aux chantiers du futur périph. Dans chaque cas, il s’agit de révéler la beauté du monde moderne. En effet, celle-ci ne s’offre pas directement au regard, mais il faut la chercher. Dans cette métamorphose de l’espace il faut trouver l’occasion d’une contemplation et d’une méditation. Les lignes droites, les courbes gracieuses et la pesanteur des bâtiments témoignent du langage spatial de l’architecture, de son rythme et même de ces rimes. Ce langage devient ainsi langage poétique. Comment dès lors ne pas céder à la tentation de s’abandonner à la rêverie ? Léa y succombe, lorsqu’elle se retrouve pour la première fois dans l’appartement de Blanche, debout devant la fenêtre, admirant la beauté du lieu : « Oui, c’est très joli. Mais ils vont mettre du gazon, ou quelque chose, non ? » demande-t-elle à Blanche.

La nature est totalement absente de ces paysages. Là où cette dernière n’est que désordonnée, anarchique et imprévisible, l’espace urbain, lui, est droit, achevé et parfait. La nature, on la retrouve toujours transformée et aménagée, comme en témoignent la base de loisir et son lac, où ça sent les « odeurs de friture et le papier gras ». En ce lieu naît alors une idylle amoureuse entre Blanche et Fabien.
Gros contraste, donc, entre le quartier aseptisé de Blanche et les couleurs vives des vêtements des jeunes filles, aux touches gaies, que l’on retrouve dans les lieux de détente et de récréation que sont le lac et ses alentours.
Aussi, rien n’est laissé au hasard. Les couleurs des vêtements fonctionnent en miroir. Le bleu et le vert, les couleurs qui dominent. Depuis la première rencontre entre Léa et Blanche à l’Hotel de Ville, jusqu’au quiproquo final, en passant par la scène de la piscine et celle de la soirée chez des amis d’amis, nos yeux se noient dans ce bleu et ce vert. Les correspondances et les symétries s’établissent, non plus restreintes à l’espace, mais cette fois-ci élargies aux personnages mêmes.

Le film semble vouloir illustrer le fameux « qui se ressemble, s’assemble », non sans se moquer parfois de manière acerbe de ses personnages en révélant leurs accès de colère. Blanche, après avoir rencontré Alexandre tout à fait par hasard, se livre à une scène pathétique de lamentations, en pleurs devant son miroir une fois de retour chez elle. Elle joue avec le sort d’une manière bien maladroite et passe ainsi à côté de sa chance. L’admiration qu’elle a pour l’image d’Alexandre la rend muette dès qu’elle le croise. Elle est incapable de prononcer des paroles sensées et devient totalement stupide, au sens où elle se trouve frappée de stupeur et comme paralysée. Le silence précède ainsi le cri et les pleurs et a souvent quelque chose d’effrayant. Lors de la promenade avec Fabien dans la forêt, un après-midi ensoleillé, le silence surgit entre les personnages et leur révèle leurs sentiments d’une manière peut-être trop brutale. Blanche cède à nouveau aux larmes.

– Tu pleures ? C’est le soleil ?, demande Fabien,
– Non, je ne sais pas, c’est peut-être ce silence. répond Blanche.
L’absence de parole témoigne d’une tension érotique entre Blanche et Fabien. Elle est ici idéale pour illustrer le développement de leur relation arrivée à maturation et prenant alors une signification amoureuse. La fiction bascule pour un court instant dans le merveilleux. Eux-mêmes comprennent le sens de cet ineffable lié à l’intime et préfèrent poursuivre ce silence dans une étreinte amoureuse, afin d’éloigner le risque de tomber dans l’ordinaire du langage et son ridicule.
Tout le génie de Rohmer est là. Il parvient à trouver dans cette métamorphose achevée de la ville l’occasion d’une méditation poétique, silencieuse et intime. Il révèle aussi la vraie nature de l’espace et des personnages, souvent ambiguë. Blanche et Léa deviennent finalement rivales, Alexandre se plaît à jouer de l’image qu’il renvoie auprès des femmes, et Fabien admet difficilement son amour pour Blanche, se réfugiant à nouveau dans les bras de Léa. Alors, que reste-t-il de vrai et de constant ? Même les bâtiments ont parfois une fonction décorative, plantés là, sans âme, semblables à des maisons de poupées. Le cinéaste ne nous invite certainement pas à aller vivre dans cet espace neuf et clos. Il se demande plutôt ce que sont la modernité urbaine et les manières de vivre et d’interagir dans ces lieux nouveaux et dépouillés de tout encrage historique.
Finalement, la résolution du quiproquo dans les dernières minutes du film vient mettre une touche optimiste à l’histoire.Elle prolonge l’utopie de l’espace dans la fiction, pour inviter le spectateur à ouvrir les yeux sur les réalités du monde moderne. Le rêve et la poésie habitent les « splendides villes », dans lesquelles il nous faut entrer, pour reprendre les mots de Rimbaud (« Adieu », Une Saison en Enfer).