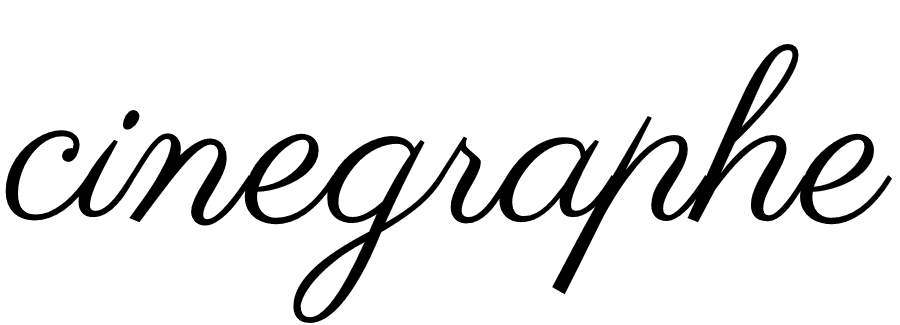Être parisien : quelle expérience commune ?
Paris est une ville chère à la Nouvelle Vague. Difficile en effet de ne pas penser à la capitale quand on évoque cette période du cinéma. Déjà dans A Bout de Souffle, dans les 400 Coups, ou encore dans Le Signe du Lion, Godard, Truffaut et Rohmer s’emparaient de divers quartiers de la capitale pour en peindre les habitudes et les habitants, à leur manière.
Le projet de Paris vu par, imaginé par Barbet Schroeder, se veut original et novateur. Il lance le défi à six réalisateurs (Claude Chabrol, Jean Douchet, Jean-Luc Godard, Jean-Daniel Pollet, Eric Rohmer et Jean Rouch) de traiter individuellement le thème de « Paris », non pour en donner une vision d’ensemble, mais dans le but d’observer des lieux autonomes et variés. Contrainte : conserver un côté expérimental, caméra 16mn, acteurs non-professionnels, équipe technique et budget réduits… Le résultat peut s’apparenter à une forme de manifeste, au moment où la Nouvelle Vague s’apprête à partir dans diverses directions.
Les six réalisateurs filment des petits mondes qui se touchent et s’entrechoquent, révélant l’écart immense qui existe entre les individus. La vie parisienne semble bien différente lorsque l’on habite d’un côté ou de l’autre de la rive. Onze stations de métro, par exemple, séparent la Gare du Nord de Saint-Germain des Près. Sur la ligne se succèdent les visages, à la manière dont se succèdent les villages quand on file en voiture sur les routes de France. Ici cependant, nous prendrons le temps de nous arrêter dans chaque lieu et découvrirons ce qu’est Paris.
Ce qui est frappant avant tout, c’est la modernité de cette oeuvre cinématographique, notamment dans sa manière de présenter les personnages féminins. Dans le film de Jean Douchet, Saint-Germain des Prés, il est surtout question de jeunesse et de plaisir, ou comment s’abandonner sans trop se préoccuper des conséquences, des amours sans lendemain. Chez Godard, dans Montparnasse et Levallois, la femme moderne est associée à toutes sortes d’étiquettes, comme celle de « pureté ». Son court-métrage est d’une grande cruauté. La femme impure est une salope, une putain qui n’est pas digne de l’amour des hommes, enfermés dans un idéal féminin les condamnant au refus de voir la réalité. Bref, elles méritent ces noms que l’on entend habituellement du côté de la Rue Saint-Denis. Mais la prostituée du film de Jean-Daniel Pollet (Rue Saint-Denis) n’en est plus une. C’est une femme gouailleuse. Elle ordonne à son client, timide maladif, de lui faire la cuisine et retarde toujours le moment de passer à l’acte.

Rue Saint-Denis, de Jean-Daniel Pollet (Micheline Dax & Claude Melki)
Elle veut partir sur la côte d’Azur, chez sa copine à Cannes. Elle a de grands rêves, tout comme la jeune femme, habitant dans le quartier de la Gare du Nord, présentée dans le film du même nom de Jean Rouch. Odile a pour seul et unique désir celui de partir très loin, au soleil, sur les îles, quitter Paris, son étroitesse et son brouhaha.
Alors on comprend qu’il ne fait pas bon vivre chez soi. Mais ailleurs, la situation est la même. Si l’argent extirpe certains de la misère sociale, il ne peut les empêcher de tomber dans un profond désespoir moral. Sur le pont enjambant les voies de la Gare du Nord, un jeune homme aisé mais désabusé n’a presque plus rien pour le retenir. Seule sa rencontre fortuite avec la jeune Odile pourrait le sauver. Mais cette femme n’est pour lui qu’une apparition, un bref moment où surgit la beauté du monde derrière un sourire, une mèche de cheveux que l’on remet en place, une démarche lente et gracieuse. Ce moment est périssable et elle-même ne peut le retenir.

Gare du Nord, de Jean Rouch (Nadine Ballot & Gilles Quéant)
Les trains, que l’on devine derrière les deux personnages au cours d’un long travelling, continueront d’aller et venir, ayant sans cesse ce mouvement horizontal, alors que l’homme préfère précipiter sa chute en tombant de tout son corps de haut en bas, sous le regard affolé de la jeune femme impuissante. Nous assistons ainsi à « ce qui précède le drame », celui d’une société bourgeoise sans idéal où la fuite est poussée jusqu’à son paroxysme. Cette société, nous la retrouvons du côté du XVIe arrondissement de Paris dans le court-métrage de Claude Chabrol, La Muette. C’est là que vivent les bourgeois et il est évident qu’ici, « l’argent ne fait pas le bonheur ». Il masque les comportements abjectes que seule la volupté du silence permet de fuir, comme le fait le petit garçon, s’enfermant s’enfermant dans la surdité au moyen de boules Quies. Aussi, mieux vaut-il être sourd à la Muette, et loin des sales petits secrets des adultes, pour qui tromperies et mesquineries marquent les différents actes de leur vulgaire comédie. Mais la tragédie n’est guère loin. Elle finit par l’emporter, précipitant à nouveau la chute, de la femme cette fois-ci, agonisant et gémissant dans les escaliers. Son mari est parti rejoindre sa maitresse. Aux plaintes désespérées cependant ne répond que le silence. Le jeune garçon préfère épouser la foule au dehors, voir le monde, être au centre tout en restant caché, s’abandonnant à la contemplation de cette forme fascinante, absolument vide de sens.
Cette foule en perpétuel mouvement, on la rencontre à la fois dans les rues et dans le métropolitain, ce lieu où l’on se retrouve sans adresser le moindre regard à son voisin de strapontin. Seules quelques consciences curieuses et observatrices osent lever les yeux de leurs journaux ou tendre l’oreille pour percevoir, derrière les bruits métalliques et électriques du wagon, les quelques paroles banales et sporadiques de passants statiques le temps d’un trajet souterrain. Le héros du court-métrage d’Eric Rohmer, Place de l’Etoile, un homme carré et droit, toujours en costume, y voyage chaque jour afin de se rendre à son lieu de travail, dans une avenue qui mène à l’étoile. Seulement voilà, à la sortie du métro, il lui est impossible d’aller tout droit sans passer par les courbes. Le chemin le plus court n’est certainement pas la ligne droite. Après une altercation grotesque avec un passant, qui se termine en une bagarre à coups de parapluie, son parcours se transforme en une course de vitesse où il risque sa vie en traversant chaque avenue.

Place de l’Etoile, Eric Rohmer (Jean-Michel Rouzière)
Le film de Rohmer se distingue des cinq autres, dans la mesure où il s’affirme en premier lieu documentaire. Aussi entendons-nous dès le début la voix off du réalisateur, présentant la topologie des lieux. Cette voix s’évanouit ensuite pour laisser place à la fiction. Le film illustre le rapport entre l’immobilité et le mouvement, au travers des déambulations plus ou moins rapides du personnage.
La voix off ne vient plus de l’intérieur et d’un point de vue subjectif, mais devient documentaire. Revenons au court-métrage de Jean Douchet. Les paroles s’ajoutent à l’image des divers endroits caractéristiques du quartier de Saint-Germain des Près afin de présenter l’espace et lui donner tout son encrage historique et sociologique. Finalement, les six réalisateurs ont cette démarche analogue de vouloir mélanger la fiction et le documentaire, en montrant comment des individus si différents peuvent appréhender un même lieu. Le regard de l’artiste se double de celui des personnages et chacun veille à percevoir d’une manière singulière et significative un lieu, à l’actualiser et à détecter les qualités de l’environnement dans lequel les relations se créent.
Mais alors, qu’est-ce qui rassemble tout ce petit monde ? On serait tenter de répondre que c’est Paris. Il y a ici six lieux, six regards, mais bien un seul Paris. Cependant l’expérience commune des parisiens ne s’arrête pas à la simple appartenance à un lieu. Elle se définit dans un ensemble de relations qui aboutit au dialogue. Un dialogue avec l’espace, un dialogue de sourd au sein de la foule, un dialogue entre les hommes et les femmes, enfin, un dialogue entre l’artiste et le spectateur.
Paris vu par, c’est donc autant de regards et de consciences qu’il y a d’individus pour composer des mondes et rendre compte du Paris des années 1960, au travers d’une mise en scène originale, tout en affirmant une absolue modernité.