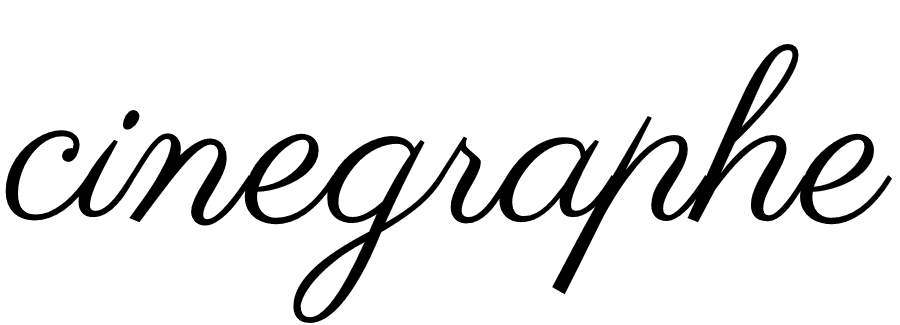Tu t’laisses aller, tu t’laisses aller…
Ces quelques mots d’Aznavour ouvrent le troisième long métrage de Jean-Luc Godard, Une femme est une femme. C’est l’histoire de deux amants, Emile et Angela. Bien qu’ils soient jeunes, ils forment déjà un vieux couple. Ils ne se parlent plus guère et passent beaucoup de temps à se quereller, d’une façon tantôt silencieuse et amusante, tantôt orageuse et bruyante.
Angela (Anna Karina) veut un enfant, et rien d’autre. Mais Emile (Jean-Claude Brialy), avec qui elle vit préfère attendre qu’ils soient mariés. Alors, après de multiples refus et sous les instances réitérées d’Angela, voici qu’elle se prend au jeu d’Emile et décide de demander au premier venu. Le « premier venu », c’est finalement Alfred (Jean-Paul Belmondo), un ami d’Emile, très amoureux d’Angela.

Angela oscille alors entre deux hommes. Est-ce là la figure de la femme moderne ? Celle qui aime deux hommes en même temps, comme la jeune femme du fait-divers des pneumatiques dont parle Alfred, que l’on retrouvera quatre ans plus tard dans le court-métrage « Montparnasse et Levallois » dans Paris vu par. L’idéal féminin s’est perdu et les rapports de force tendent à pencher tantôt du côté de la femme, tantôt de l’homme, sans véritable équilibre ni parfaite domination. Emile veut plaire à Angela et se sentir aimé d’elle. « Dis moi quelque chose de gentil », lui demande-t-il, sans succès, tout comme le faisait Patricia (Jean Seberg) avec Michel Poiccard (Jean-Paul Belmondo) dans A bout de Souffle (1960). Emile rentre du travail, lit son journal, et Angela accepte avec ironie et dédain d’endosser le rôle de petite femme modèle, cuisinant pour son homme, avant d’anéantir cette comédie, de congédier définitivement le bavardage badin et de céder aux larmes : « Moi je trouve con les femmes qui ne pleurent pas, les femmes modernes qui veulent imiter les hommes ».
Finalement, la femme moderne est un homme. Du moins, elle tente de le devenir par mimétisme. Adieu les sentiments, adieu le pathétique. Tout cela doit rester caché au plus profond de l’être et ne jamais être extériorisé ou exprimé. Alors les tableaux s’enchaînent et la femme n’est plus qu’un objet soumis aux regards. Angela est strip-teaseuse dans un cabaret miteux aux décors rouges et aux rares clients. Son vulgaire quotidien théâtral est bien loin de ses aspirations idéales de paillettes, chansons et danses qu’elle tente de reproduire en prenant différentes poses plus ou moins grotesques avec Alfred, dans de beaux habits et non plus dénudée comme au cabaret. C’est au tour d’Alfred de jouer le rôle d’imitateur. Il reproduit les figures d’Angela parce qu’il l’aime et relève son défi, ce qui donne lieu à un enchaînement rapide et saccadé de tableaux au beau milieu d’une petite rue poussiéreuse. Les pas de danse ne se suivent plus selon un ordre chronologique, mais sont extirpés à la chorégraphie et deviennent indépendants, comme des clichés photographiques où la mise en scène se laisse deviner.

Mais la rue n’est pas le seul espace où se déploient la musique et les corps. Au sein de leur appartement, Angela et Emile ne cessent d’enchaîner les scènes comiques et tragiques. De surcroit, le drame romantique n’est pas loin. Alors, dans quel genre sommes-nous ? Quoiqu’il en soit, le petit appartement où l’on passe aisément d’une pièce à l’autre par un simple mouvement de caméra et grâce au CinémaScope se transforme bien vite en un théâtre. Le spectateur en fait partie intégrante. Maintes fois les personnages s’adressent directement à lui. Regards caméra, saluts, clins d’oeil… tout est là pour lui rappeler son existence au sein de la fiction, au sein du « chef d’oeuvre », comme dit Alfred à la fin du film. Dès lors, la frontière qui sépare le public de la scène a disparu, tout comme celle séparant le personnage de l’acteur. Les didascalies surgissent brusquement à l’image, au devant de la scène, s’affichant dans un sens puis dans l’autre, selon le mouvement de la caméra.
Alors on comprend qu’Emile et Angela jouent sans cesse. Ils jouent avec l’amour, les codes sociaux, mais aussi, et surtout, avec le langage. La scène de ménage devient alors silencieuse et présente le combat acharné de l’image et du son, et ce dernier sort vaincu. « Je ne te parle plus ! ». Les deux personnages s’enferment finalement dans leur silence et procèdent à un rituel minutieux avant de se mettre au lit. Incapables de ne pas communiquer, ils inventent alors un nouveau langage à partir de mots empruntés. Ils promènent la lampe à pied dans le noir jusqu’à une modeste bibliothèque, choisissent quelques livres qu’ils se montrent ensuite en guise de moyen d’expression. Les premières de couverture et les titres s’enchaînent : Monstre, Bourreau, Momies péruviennes, ou encore Eva accompagné de « te faire foutre » qu’Emile rajoute au crayon sur la couverture. Le silence n’est donc pas une absence de langage. Les personnages se servent de ce qui est déjà écrit, extirpent le mot de sa signification littéraire pour lui donner un sens nouveau et intime.

Le spectacle est donc tantôt sonore, tantôt muet, mais aussi esthétique. Les couleurs vives fusent et se répondent au rythme des néons clignotant dans la nuit. Mais le tableau naïf et parfois frivole laisse entrevoir les failles d’une société fragilisée. Les cocos lecteurs de l’Humanité sont regardés avec méfiance. Dans le contexte de la guerre d’Algérie, un attentat peut avoir lieu n’importe où et n’importe quand – « Un type a jeté une bombe sur le boulevard » dit la police à Emile et Angela en fouillant leur appartement -, la femme doit se dévêtir pour se vêtir et vivre décemment, les hommes perdent leur temps dans les cafés et multiplient les magouilles pour se procurer de l’argent.
Alors, heureusement, il y a le rêve, auquel nos trois personnages idéalistes et amoureux se laissent aller. Le film met donc en scène la vie qui n’est ni une tragédie, ni une comédie, mais bien « un chef d’oeuvre » en couleur, avec ses tons optimistes, ses airs joyeux et euphoriques, où se côtoient Musset et le fait divers.
« Angela, tu es infâme », dit Emile. « Non, je suis une femme. », répond-elle, sur un ton à la fois impertinent et amusé, regard caméra. Touche finale qui vient relancer et résumer avec brio le jeu enfantin et amoureux.