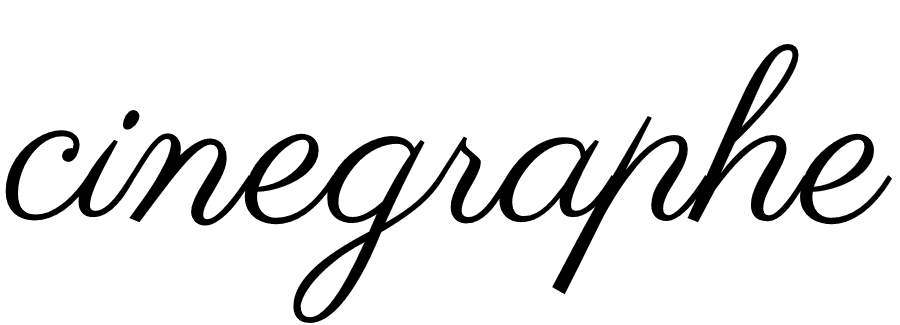« M’as-tu pas fait par écriture entendre, / Que tout venait à point, qui peut attendre ? »
Marot, Élégies (XV)
Premier volet de la série des Six contes moraux, La Boulangère de Monceau d’Éric Rohmer (1963) dresse un canevas thématique qui sera commun à ses cinq films suivants : un homme s’éprend d’une femme, parfois croisée dans la rue, mais, celle-ci introuvable pour un temps, il s’amourache d’une autre pour satisfaire un désir qui s’étiole, jusqu’à ce qu’il retrouve enfin celle qu’il a initialement aimée. Cette peinture de l’inconstance et de la légèreté amoureuses lève le voile sur l’intime du protagoniste : ses réflexions, ses observations, ses motivations sont données à entendre dans un discours narratif tout introspectif, parfois sans pudeur ni mesure. Cette narration au passé trouve un support d’existence dans l’image cinématographique même qui la rend présente et vivante au spectateur. Comme les pages d’un livre, l’écran s’approfondit grâce au discours ; ou inversement, la puissance de la parole, poignant des profondeurs de l’être, fait naître les images.
Les personnages (au nombre de trois, si l’on retranche Schmidt, ami et camarade du narrateur, qui n’est là que pour lui signifier la présence physique de Sylvie et pour affermir son courage pleutre) évoluent dans un Paris réduit à quelques rues assourdissantes jouxtant le carrefour Villiers. C’est dans ce quartier que le narrateur baguenaude, traîne dans les cafés et promène un désir réel mais timide, à la recherche de Sylvie, toujours entrevue, jamais abordée. Cette beauté fugitive, qui n’apparaît que quand on parle d’elle, ressemble à la femme surréaliste surgissant de la foule comme un éclair fascinant. L’œil du narrateur est alors frappé d’éblouissement, et c’est le début de l’amour. Le début de La Boulangère se concentre sur cet innamoramento, lequel construit le prétexte à la déambulation motivée.
Toutefois, la femme, à peine accostée, disparaît. L’absence de l’aimée appelle une autre topique de la lyrique amoureuse : la quête. Le narrateur s’abandonne à la rêverie poétique, au souvenir d’une vision toujours inscrite en sa mémoire, et poursuit, semble-t-il, un fantôme. Il arpente les rues, bat le pavé, attentif au moindre signe, mais finalement déçu. Le désir, lui, sonne de l’olifant, entraîne celui qui l’éprouve dehors, toujours à la recherche de l’être perdu. Devenu insupportable, cependant, il se porte, pour se rassasier, sur une tierce personne : la fameuse boulangère de la rue Lebouteux, jeune fille de dix-huit ans, brune, au teint frais et vif, aux traits délicats et aux charmes légers, les cheveux en bataille descendant sur un front d’albâtre et tirés derrière des oreilles nues, au nez oblong dont la courbe remonte jusqu’à la glabelle d’où partent d’adroits sourcils, ressemblant aux traits d’un calligraphe à l’encre de chine, et sous lesquels, enfin, resplendissent des yeux allègres et sémillants.

Une routine s’installe entre ces deux personnages : le narrateur vient d’abord acheter un sablé qu’il mange une fois sorti de la boulangerie. Peu à peu, quand il se rend compte qu’elle tombe sous son charme (dont il ne se dit pas surpris, avec une effronterie orgueilleuse, car fier de sa grâce qu’il brandit ouvertement), il se procure, soit par gourmandise, soit par opulence, deux sablés, un pain au lait, un gâteau lorrain, un tarte aux abricots… Les achats – qui sont le moment où les mains des personnages se rencontrent, après leurs yeux – tissent une relation de complicité, de séduction monodique : seule la boulangère, en réalité, développe une passion qui sera, à la fin, offensée et dont le destin sera à imaginer par le spectateur.

Le narrateur propose – non sans audace – à la boulangère de sortir au cinéma, sortie qu’elle accepte finalement en lui tendant deux sablés le jour suivant (un sablé pour « non », deux pour « oui »). Quel était le but, au fond, de cette sortie ? Soit pour satisfaire une fatuité, parfois ridicule, que le narrateur n’hésite pas à faire sienne ; soit pour substituer à un désir ferme mais depuis trop longtemps affamé, un nouveau qui pourrait se repaître quand bon lui semblerait ; soit pour sceller une amourette éphémère. Fallait-il voir, dans le pain au lait et le sablé, des signes phallique et vaginal ? Cette interprétation semble trop loin de la poétique rohmérienne, et les pâtisseries représenteraient plutôt le triangle amoureux mis en place.

Quoi qu’il en soit, les lois de l’amour offrent cependant des surprises et dictent le destin des hommes, dont aucune volonté ne peut s’affranchir. Le jour même du rendez-vous, Sylvie reparaît, boitant, appuyée sur une canne et la cheville bandée, mais toujours comme une illumination, répétant, et cette fois aboutissant, le schéma narratif qui orchestrait le début du film : les yeux de Sylvie et ceux du narrateur se rencontrent mais aucun n’a la hardiesse de se parler (n’est-ce pas le meilleur moyen d’entretenir un désir ?). Cette fois, ils décident de sortir ensemble, et Sylvie explique son absence soudaine et prolongée. Dans sa convalescence, elle observait, de sa fenêtre, la rue (celle-là même de la boulangerie !) et les allées et venues du narrateur. L’œil est alors le prolongement du cœur. Finalement, l’amour originaire triomphe : les deux personnages se marient six mois après leur première sortie.
P.