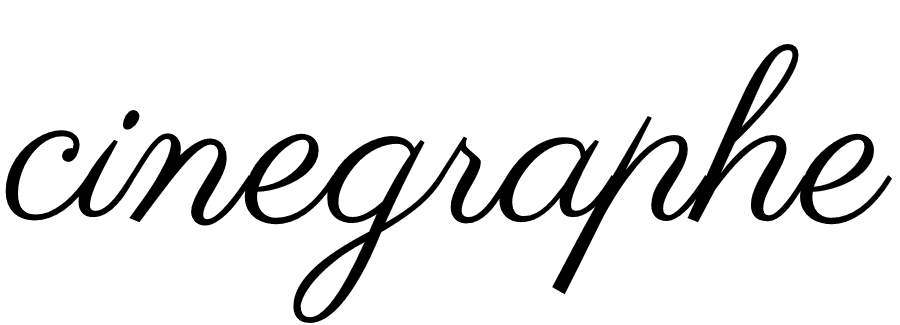Croyez-moi, nos morts peuvent continuer à vivre
Le personnage de Julien Davenne, dans La Chambre verte, film de François Truffaut sorti en 1978, fait du souvenir des morts une lutte contre le caractère éphémère et passager de la vie elle-même.
Le film met en scène un homme obsédé par les morts qui refuse l’oubli, quelques années après la Première Guerre mondiale. Davenne, ancien soldat des tranchées, interprété par Truffaut lui-même, veut aimer ses morts comme on aime les vivants. Sa femme est décédée peu de temps après leur mariage. Il consacre alors la plus grande partie de son temps à son souvenir, dans la mystérieuse chambre verte, où il conserve des objets lui ayant appartenu et des photographies qui la représentent, faisant d’elle un fantôme. Cette obsession au caractère assez morbide va plus loin : Davenne souhaite que ses morts aient un endroit où ils pourraient vivre pour toujours. Il décide alors de faire d’une ancienne chapelle le lieu du culte de ces fantômes. Tous ceux qu’il a connus sont réunis, leurs portraits sont au mur et leur souvenir est rappelé par d’innombrables flammes qui célèbrent la vie à travers la mort. Davenne ne vit plus que pour eux et est incapable de reconnaître la vie lorsqu’elle se présente et s’offre à lui, comme le suggère le personnage interprétée par Nathalie Baye, Cécilia, qui finit par tomber amoureuse de lui.

La Chambre verte est d’abord l’histoire d’un homme hanté par l’obsession de refuser l’oubli. Julien Davenne décide d’offrir à ses morts une grande célébration lumineuse, dans laquelle il les rassemble tous pour vivre avec eux. Truffaut a l’habitude de trouver son inspiration dans la littérature, que ce soit par exemple en adaptant les romans d’Henri Pierre Roché, Jules et Jim et Les deux Anglaises et le Continent. Son travail sur les adaptations littéraires se fait notamment avec le scénariste Jean Gruault, qui a participé à l’écriture du scénario de La Chambre verte. Ce film est tiré d’une nouvelle d’Henry James, L’Autel des morts, parue en 1895. D’autres idées lui viennent également de différentes nouvelles de James, ce qui lui permet de prendre des libertés par rapport à l’histoire initiale. Truffaut conserve la trame principale et rend hommage à l’écrivain américain en faisant figurer son portrait parmi les morts de la chapelle : c’est par lui que Davenne dit avoir appris l’importance du respect et du souvenir des morts. Au départ, La Chambre verte devait avoir pour titre La Fiancée disparue, ce qui souligne d’emblée l’idée de la perte et de la mort, et surtout du souvenir obsessionnel et douloureux. La modification la plus significative que se permet Truffaut par rapport à la nouvelle de James et qui rend bien compte de sa propre perception de la relation amoureuse réside dans le statut du personnage principal et de la femme défunte. Chez James, elle est sa fiancée et meurt juste avant leur mariage. Chez Truffaut, Davenne et Julie sont déjà mariés lorsque celle-ci décède. L’amour charnel n’est pas un obstacle et le culte de Julie après sa mort révèle un amour exclusif et éternel qu’il perpétue dans la chambre verte, ancienne chambre de sa défunte épouse.
La couleur de la chambre n’est pas le fruit du hasard. Si Truffaut a largement été influencé par la littérature de James, il l’a aussi été par le cinéma d’Alfred Hitchcock, chez qui le thème du fantôme et du souvenir d’un personnage disparu est fortement présent, notamment dans Rebecca et Sueurs froides. Le spectateur ne sait pas très bien dans quelles conditions la femme de Davenne est morte. Il ne sait d’elle que ce que le souvenir du héros laisse transparaître et tout ce qu’il conserve d’elle dans cette chambre austère et froide, qui sous certains aspects rappelle la chambre de Rebecca. Dans les deux films, la pièce devient un mausolée où les objets ayant appartenu à la morte sont conservés et exposés comme des pièces de musée. Le spectateur entre pour la première fois dans la chambre verte assez tardivement, aux côtés du personnage, qui vient de retrouver la bague de son épouse. La pièce est petite, sombre, les grands rideaux sont fermés et Davenne passe la bague au doigt d’une fausse main. « J’ai retrouvé ta bague, Julie », dit-il. Son épouse n’est pas morte à ses yeux, il continue de vivre avec elle, d’entretenir son souvenir allant jusqu’à le matérialiser. Cette matérialisation assez caricaturale de l’amour et de sa tragédie atteint son paroxysme dans le mannequin de cire que Davenne fait fabriquer et finit par détruire. Cet objet effrayant rend à la fois compte du manque que le personnage s’acharne à combler, mais aussi du fantôme qui prend vie, qui devient un corps inanimé et factice. La figure de cire que le héros a fait naître se dresse comme une créature monstrueuse qui ne correspond absolument pas aux attentes du personnage, bel et bien prisonnier de son souvenir. Tous ces efforts pour reconstituer l’image d’une morte sont semblables à la démarche de Scottie, le héros de Sueurs froides, qui va jusqu’à demander à Judy de s’habiller et de se coiffer comme Madeleine, tout comme le faisait déjà Hugues Viane avec Jane Scott dans le roman Bruges-la-Morte de Georges Robenbach. A l’instar d’Hitchcock, qui montrait un homme amoureux d’une femme vêtue de vert, Truffaut associe ici cette couleur à un amour impossible et tourné vers la mort, ce qui donne à son film un air de roman gothique anglais. Rarement le spectateur pénètre dans la chambre verte, alors même que tout semble émaner de cette pièce, qui renferme un secret intime et douloureux.
 Davenne voue un culte aux morts, tout comme le personnage de la nouvelle de James, qui les appelle les Autres — « the Others » —. Cependant, les vivants finissent par apparaître comme morts aux yeux du personnage, qui est incapable de saisir la vie lorsqu’elle se présente. La possibilité d’une histoire d’amour entre Davenne et Cécilia est envisagée dès leur première rencontre, mais jamais le spectateur ne verra ses attentes confirmées. Le héros oublie d’aimer les vivants, la réalité n’existe plus que pour le souvenir du passé. Truffaut rend bien compte de cette dimension en particulier grâce au travail de son chef opérateur, Nestor Almendros, qui a notamment travaillé avec Eric Rohmer. Les visages, souvent filmés de très près, sont semblables à des statues, les personnages sont montrés dans un cadre étroit, dans des lieux sombres aux couleurs ternes. L’atmosphère est triste et la nostalgie envahit l’écran. Le passé, le présent et le futur sont tous tournés vers la mort. Le culte de Davenne a pour but de faire vivre les morts, de les rendre toujours présents, et s’oppose ainsi à ce que prétend faire la religion, tournée vers un au-delà, un autre monde où règnerait la vie éternelle, comme l’affirme le personnage au début du film, lors d’une veillée funèbre. Le héros entre en conflit avec le prêtre, et la scène est poussée à son extrême. La violence provocatrice de Davenne se mêle à la désinvolture pour attaquer la routine catholique. La résignation est dénoncée comme une consolation mensongère. « J’ai décidé que si elle était morte pour les autres, pour moi elle était toujours vivante », proclame le héros au sujet de sa femme. Son refus de l’attitude religieuse à l’égard du souvenir va plus loin. Lorsqu’un soir la chambre verte prend feu, il ne lui reste plus que le cimetière pour pleurer sa morte. Mais cela ne lui suffit pas, et à partir de ce moment là, il décide de transformer l’ancienne chapelle du cimetière en immense célébration du souvenir de tous ceux qu’il a connus et qui sont morts, chacun ayant sa propre flamme et son portrait accroché au mur.
Davenne voue un culte aux morts, tout comme le personnage de la nouvelle de James, qui les appelle les Autres — « the Others » —. Cependant, les vivants finissent par apparaître comme morts aux yeux du personnage, qui est incapable de saisir la vie lorsqu’elle se présente. La possibilité d’une histoire d’amour entre Davenne et Cécilia est envisagée dès leur première rencontre, mais jamais le spectateur ne verra ses attentes confirmées. Le héros oublie d’aimer les vivants, la réalité n’existe plus que pour le souvenir du passé. Truffaut rend bien compte de cette dimension en particulier grâce au travail de son chef opérateur, Nestor Almendros, qui a notamment travaillé avec Eric Rohmer. Les visages, souvent filmés de très près, sont semblables à des statues, les personnages sont montrés dans un cadre étroit, dans des lieux sombres aux couleurs ternes. L’atmosphère est triste et la nostalgie envahit l’écran. Le passé, le présent et le futur sont tous tournés vers la mort. Le culte de Davenne a pour but de faire vivre les morts, de les rendre toujours présents, et s’oppose ainsi à ce que prétend faire la religion, tournée vers un au-delà, un autre monde où règnerait la vie éternelle, comme l’affirme le personnage au début du film, lors d’une veillée funèbre. Le héros entre en conflit avec le prêtre, et la scène est poussée à son extrême. La violence provocatrice de Davenne se mêle à la désinvolture pour attaquer la routine catholique. La résignation est dénoncée comme une consolation mensongère. « J’ai décidé que si elle était morte pour les autres, pour moi elle était toujours vivante », proclame le héros au sujet de sa femme. Son refus de l’attitude religieuse à l’égard du souvenir va plus loin. Lorsqu’un soir la chambre verte prend feu, il ne lui reste plus que le cimetière pour pleurer sa morte. Mais cela ne lui suffit pas, et à partir de ce moment là, il décide de transformer l’ancienne chapelle du cimetière en immense célébration du souvenir de tous ceux qu’il a connus et qui sont morts, chacun ayant sa propre flamme et son portrait accroché au mur.
Le héros est possédé par une idée fixe qui le hante et le trouble. Toute sa vie, Davenne attend un événement, mais finit par passer totalement à côté. Cécilia, cette jeune femme douce qui s’occupe des objets du passé liés à des morts dans une salle de vente, est attirée par cet homme avec qui elle partage le souvenir d’un mort. L’aveuglement de Davenne est tel que l’histoire d’amour restera impossible. Lorsqu’il propose à Cécilia d’être la « gardienne du temple », ses paroles au ton solennel raisonnent comme une demande en mariage. « Pour être aimée de vous, il me faudrait être morte », lui dit-elle. Cette obsession se comprend notamment au regard de l’époque de l’histoire. Les conséquences de la Grande Guerre sont omniprésentes. Le générique de début illustre à la fois l’idée de la mort et de la guerre : les scènes se succèdent lentement et l’effet de surimpression laisse voir les images d’archive aux reflets verts des tranchées et le visage de Truffaut/Davenne, mélancolique. Le cinéaste s’expose dès le début du film et fait du générique une sorte d’autoportrait. La transposition de la nouvelle de James dans le contexte de l’après-guerre permet de donner une justification plus ample à l’obsession morbide du personnage principal. La Grande Guerre est rappelée à plusieurs moments, plus ou moins discrètement, comme lorsque le héros projette des images violentes à l’enfant sourd-muet, ou lorsque le rédacteur du journal où il travaille dit que « dans (notre) région il y a peu d’hommes de la génération de Davenne à marcher sur leurs deux jambes ». Truffaut avait déjà traité du thème de la Première Guerre mondiale dans deux de ses précédents films, Jules et Jim et Les deux Anglaises et le Continent. Les fantômes de la guerre hantent certains films du cinéaste et accompagnent l’idée d’un amour impossible, menacé par la mort. Les héros ont souvent des difficultés à accepter ce qui est éphémère et incertain, comme Mathilde dans La Femme d’à côté, Catherine dans Jules et Jim, ou Davenne qui meurt en allumant la dernière bougie de sa célébration qui « achève la figure ».

Si la mort est un obstacle à l’amour, elle l’est aussi au souvenir. Les portraits qui ornent les murs de la chambre verte et ceux de la chapelle rappellent que le souvenir des morts passe par l’image. Dans La Chambre claire, Roland Barthes rend compte de sa volonté d’ « entourer de (s)es propres bras ce qui est mort, ce qui va mourir », avec la photographique. L’image fixe est avant tout fantomatique, spectacle, et ne peut contenir toute la vie d’un homme, jusqu’à sa mort. C’est pourtant ce que tente de faire Davenne/Truffaut en voulant rendre ses morts vivants, grâce à la photographie et à l’image. En février 1970, le cinéaste écrit à Tanya Lopert qui vient de perdre son père, responsable des Artistes Associés en Europe : « Il y a beaucoup, beaucoup trop de morts autour de moi, que j’ai aimés, et j’ai pris la décision, après la disparition de Françoise Dorléac, de ne plus assister à aucun enterrement, ce qui, vous le pensez bien, n’empêche pas la tristesse d’être là, de tout obscurcir pendant un temps et de ne jamais s’estomper complètement, même avec les années, car on ne vit pas seulement avec les vivants, mais aussi avec tous ceux qui ont compté dans notre vie ». La chapelle est aussi le musée intime et personnel de Truffaut. Il mêle les portraits d’hommes et de femmes qui ont compté pour lui, aussi bien des écrivains, des artistes, des acteurs, qu’il a connus personnellement ou non. Il joue sur les anachronismes et les clins d’œil : Oscar Lewenstein, qui a joué dans Les deux Anglaises et le Continent le rôle de l’arbitre lors du projet de mariage de Claude et Muriel, est présenté ici comme un « champion de l’arbitrage des conflits », Oskar Werner, avec qui Truffaut s’est disputé sur le tournage de Fahrenheit 451, devient un soldat allemand mort au combat. Il y a aussi les portraits de Proust, Cocteau, Queneau, Prokoviev, Oscar Wilde, et Serge Rousseau, ami proche du cinéaste qui apparaît à la fin de Baisers Volés. Maurice Jaubert, compositeur de nombreuses musiques de films classiques des années 1930 et mort en 1940, a aussi son portrait, et c’est sa musique que le spectateur entend dans La Chambre verte. Les photographies qui ornent les murs de la chapelle permettent ainsi à Truffaut de vouer un culte au cinéma lui-même, et donc aux images. Le cinéma, par ses photogrammes, fixe le portrait des actrices et des acteurs pour leur donner un présent éternel. C’est Truffaut lui-même qui s’exprime au travers de son personnage lorsqu’il dévoile à Cécilia la chapelle illuminée.
La Chambre verte est donc une manière de définir le cinéma, qui ne peut vivre que par ses fantômes, car il les porte constamment en lui et les rend vivants. Deux aspects du cinéma de Truffaut se rencontrent ici : à la fois celui inspiré de la littérature, mais aussi et surtout celui venant de sa propre vie et de ses souvenirs. Si le film n’a pas eu beaucoup de succès à sa sortie, il ouvre cependant une porte possible vers toute l’œuvre du cinéaste, qui se présente comme un projet romanesque aux accents balzaciens, Truffaut y laissant toujours des indices évoquant ses précédents films.
Tout au long de son œuvre, Truffaut mélange les tons légers et graves. L’oscillation entre la vie et la mort se retrouve dès son premier long-métrage, Les Quatre-Cents Coups, qui alterne des moments heureux et innocents, portés par le jeune Jean-Pierre Léaud, avec des instants sérieux et sévères. La mort est toujours là, elle n’est jamais mise à distance. Dans La Nuit américaine, sorti en 1973, Truffaut rendait déjà hommage au cinéma, en mettant en scène le tournage d’un film. Il en montre certes les rires et la joie, mais ne s’enferme pas dans l’illusion d’un bonheur éternel. Avec La Chambre verte, le cinéaste poursuit son culte du cinéma d’une manière plus grave, mais confirme l’idée que son art est un refuge. La vérité et le cinéma se mêlent, et tous deux regardent la mort en la mettant à distance sans jamais la nier mais en l’acceptant, pour que la vie devienne supportable avant tout comme phénomène esthétique.