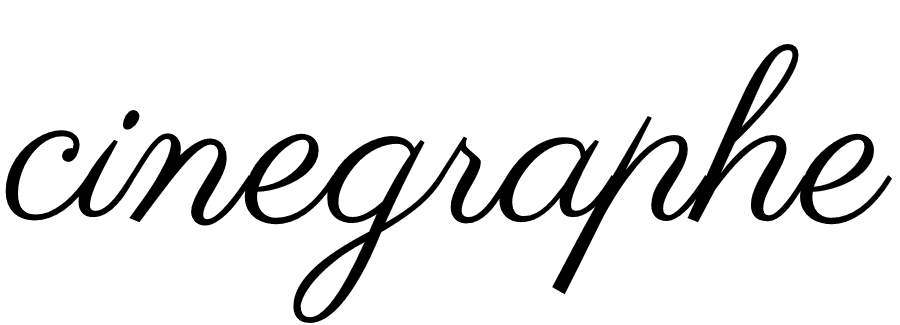Rien ne distingue les souvenirs des autres moments.
En 1962, Chris Marker sort un film expérimental, La Jetée, composé uniquement de clichés photographiques, à l’exception de quelques secondes où les images s’animent. Ce « photomontage » ou « photo-roman » est à la fois un film de science-fiction et une fable psychologique, où les représentations du temps, de l’espace et de la vie psychique s’entremêlent. La narration est entièrement faite par la voix off de Jean Négroni, qui commente les évènements et permet de donner au spectateur des repères temporels à l’histoire. La jetée du titre est celle d’Orly, où les Parisiens viennent voir les avions décoller et atterrir. Elle apparaît comme un lieu de passage, un abri, un point de départ et un point d’arrivée. L’histoire choisit de se concentrer sur un anonyme, un « homme marqué par une image d’enfance ».
Le récit post-apocalyptique plonge le spectateur dans un Paris complètement détruit après la Troisième Guerre mondiale. Paris est dévastée, les images des dégâts s’enchaînent et laissent voir une ville en ruine : l’Arc de Triomphe est coupé en deux, le ciel est noir et rempli de fumée, les bâtiments sont ravagés. Ces images truquées et retravaillées rappellent les photographies prises à Hiroshima en août 1945, notamment celles du Dôme de Genbaku, seul édifice de la ville a être resté debout. Dans La Jetée, les vainqueurs font des expériences sur les survivants prisonniers dans les souterrains. Les scientifiques chuchotent en allemand. L’espace ouvert, du dehors, n’est plus habitable, car radioactif : « La surface de Paris, et sans doute de la plus grande partie du monde, était inhabitable, pourrie par la radioactivité ». Le seul refuge se trouve donc dans les souterrains du Palais de Chaillot, d’anciennes carrières situées sous le palais du Trocadéro. Ces hommes et femmes sont partagés entre les vainqueurs, qui « montent la garde sur un empire de rats », et les vaincus, prisonniers et cobayes soumis à diverses expériences scientifiques qui visent à trouver un moyen de sortir des souterrains.

L’espace est confiné, inquiétant et insalubre. La mort est présente partout. « Au terme de l’expérience, les uns étaient déçus, les autres étaient morts, ou fous ». L’image d’un couloir vide, peu éclairé, à l’issue inconnue, accompagne la narration. Tout au long du film, le contraste entre les dominants et les dominés persiste. Ici, le but de l’expérience est simple en apparence : « projeter dans le temps des émissaires, appeler le passé et l’avenir au secours du présent. Mais l’esprit humain achoppait. Se réveiller dans un autre temps, c’était naître une seconde fois, adulte. Le choc était trop fort ». La peur, comme la mort, règne dans les souterrains, et le progrès n’est pas synonyme de bien-être. Les scientifiques apparaissent comme des rats vivant dans ces galeries qui ont pour but d’atteindre un espace futur pour le coloniser, mais aussi comme de petits hommes coincés dans la caverne, éloignés de la vraie vérité qui se trouve à l’extérieur et qui est désormais inaccessible, car trop dangereuse et détruite par le progrès et la science. Dès lors, où se trouve le vrai monde ? Dans le temps, dans les souvenirs. Lorsque le sujet de l’expérience parvient à traverser les couloirs du temps, les premières images qu’il voit sont heureuses : « Un matin du temps de paix. Une chambre du temps de paix, une vraie chambre. De vrais enfants. De vrais oiseaux. De vrais chats. De vraies tombes. » Le vrai monde n’existe plus dans l’espace, mais bien dans le temps, un temps préservé par le souvenir, hors du progrès et des ravages de la science. Ces expériences questionnent la vocation de la science, et rappellent les théories de Max Weber dans Le Savant et le Politique. Weber explique en effet que pour ceux qui vivent dans le progrès, la possibilité d’un nouveau progrès est toujours envisageable. Ils sont placés dans le mouvement d’une civilisation qui s’enrichit continuellement de pensées, de savoirs et de problèmes. Il interroge le but de l’activité scientifique dans l’ensemble de la vie humaine, et sa valeur. Ici, une fois que le progrès, symbolisé également par la bombe atomique et les ravages de la Seconde Guerre mondiale, a détruit toute possibilité de vie à la surface de la Terre, une question importante se pose : comment le progrès peut-il encore conférer du sens à la vie ? Le sens n’existe plus dans cette vie souterraine. Les individus sont plongés dans l’infini et espèrent trouver une réponse dans un passé et un futur qui doivent leur venir en aide au présent. Le mythe platonicien de la caverne est inversé : les hommes sont prisonniers, ils n’ont pour seule réalité que ce théâtre d’ombre et de lumière artificielle sous la terre, et celui qui parviendra à s’en échapper par le temps y est contraint et forcé. Si le monde « idéal » et la vraie réalité ne résident plus à la surface, donc dans l’espace, il faut aller les chercher dans le temps. Deux dimensions se superposent alors : celle des souterrains, comme lieu de l’enfermement, de la mort, de l’absence ou plutôt de la perte de savoir, et celle du temps, comme lieu de la liberté, de la vie, de la connaissance.
Sortir à la surface est possible grâce au temps. « Les inventeurs se concentraient maintenant sur des sujets doués d’images mentales très fortes. Capables d’imaginer ou de rêver un autre temps, ils seraient peut-être capables de s’y réintégrer », dit le narrateur. Le temps, l’espace et l’image sont associés. Les images mentales sont constituées de souvenirs. L’homme choisi entre mille a été marqué « par une image d’enfance », une image violente, celle d’un visage de femme et d’un homme en train de mourir subitement, sur la jetée d’Orly. Le souvenir est remis en question cependant : « Ce visage qui devait être la seule image du temps de paix à traverser le temps de guerre, il se demanda longtemps s’il l’avait vraiment vu, ou s’il avait créé ce moment de douceur pour étayer le moment de folie qui allait venir ». La jetée, par l’envol et la liberté qu’elle suggère, vient ici s’opposer aux souterrains. Elle renvoie à un temps passé, un temps de paix, où régnaient l’insouciance et la légèreté associées à l’enfance. L’espace, dans le présent, est anéanti, et le temps est donc la seule dimension intacte. Il ne se mesure pas et devient extensible et vertigineux. Comme Scottie et Madeleine dans Vertigo d’Alfred Hitchcock, l’homme anonyme retrouve la femme dont le visage l’avait marqué enfant devant la coupe d’un séquoia, couverte de dates historiques : « Comme en rêve, il lui montre un point hors de l’arbre. Il s’entend dire : Je viens de là… ». Grâce au voyage dans le temps, l’homme se construit de nouveaux souvenirs à partir de ce visage gardé dans sa mémoire. Comme Madeleine, cette femme belle et mystérieuse n’a pas d’identité propre, elle conduit l’homme et le spectateur dans le vertige du temps.

Le pouvoir d’évocation du passé est ici surtout lié à l’image et à la vision, qui permettent à l’homme de sortir du souterrain, par l’imaginaire, et non plus seulement à l’odorat et au goût comme chez Proust. Cette fascination rend compte d’une archéologie du cinéma. Les souterrains, sombres, sont comme une chambre noire dans laquelle les images défilent. Les différentes temporalités sont imbriquées, le temps n’est plus linéaire et l’image vient organiser le récit, afin d’assurer une certaine continuité face aux paradoxes de la mémoire et du temps vécu. Le choix de la forme de photo-roman permet d’illustrer le propos implicite du film. Le cliché photographique se pose comme le souvenir partiel et sélectif de la conscience. La mémoire est imparfaite et le souvenir est une image, rien qu’une image, et non vingt-quatre par seconde. Les dernières photographies qui ponctuent le film laissent voir la chute de l’homme qui meurt sur la jetée, avec sa gestuelle exacerbée et ses mouvements découpés et saccadés, rappelant le travail de Muybridge et la chronophotographie. L’homme qui tombe est comme Icare, et le spectateur apprend qu’il s’agit en fait de l’homme cobaye anonyme des souterrains. « Il comprit qu’on ne s’évadait pas du Temps et que cet instant qu’il lui avait été donné de voir enfant, et qui n’avait pas cessé de l’obséder, c’était celui de sa propre mort ». A vouloir trop retrouver ce souvenir d’enfance qui l’obsédait, l’homme est mort en se sachant prisonnier d’une boucle temporelle vertigineuse.

L’homme a recréé un temps passé subjectif, son histoire devient intemporelle et la mémoire est avant tout pensée en termes d’espace, comme une photographie. Malgré cette capacité à voyager dans le temps, l’homme est précipité vers sa propre mort. Roland Barthes, dans La Chambre claire, rend compte de sa volonté d’« entourer de (s)es propres bras ce qui est mort, ce qui va mourir », avec la photographie. L’image fixe est avant tout spectrale et peut contenir toute la vie d’un homme, jusqu’à sa mort, en la condensant dans une image photographique. Barthes poursuit sa réflexion en distinguant le « studium » — les renseignements que la photo transmet, les significations qu’elle accueille —, et le « punctum » — le « ça a été », comme présence sensible brute, qui affecte sans signifier. L’importance pour Barthes est la poétisation de l’image et sa valeur esthétique est avant tout située dans la conjonction de son affirmation formelle et de sa valeur signifiante. L’image doit donc se risquer à ne plus être la simple représentation de quelque chose, pour ouvrir en elle un nouveau mode de présence à l’apparaître et au sens. C’est dans les images mentales de l’homme anonyme, qui ont une fonction de libération et d’ouverture sur un nouveau monde et une nouvelle temporalité, que le film naît et se déroule, en faisant paradoxalement apparaître l’horizon de la mort, donnée par l’homme mystérieux aux lunettes noires.
La Jetée est avant tout une rêverie poétique sur le souvenir, la mémoire, et la possibilité de l’oubli comme condition du bonheur et unique chemin vers le temps retrouvé. « Il est possible de vivre presque sans souvenir et de vivre heureux, (…) mais il est encore impossible de vivre sans oubli », écrit Nietzsche dans les Considérations inactuelles. En 1983, vingt ans après La Jetée, Chris Marker poursuit sa réflexion sur le temps et la mémoire en imaginant un film qu’il ne fera pas dans Sans Soleil, celui d’un « homme qui a perdu l’oubli », malheureux car incapable d’imaginer le souvenir.