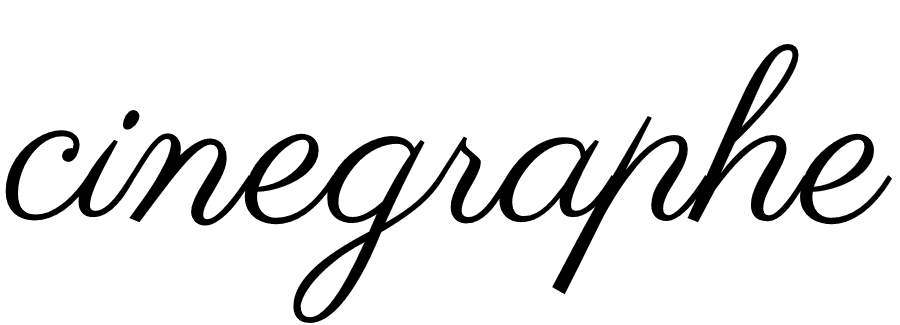Parce qu’ils sont enfants, ils sont innocents
Nombreux sont les enfants dans l’œuvre cinématographique de François Truffaut. Qu’ils soient au centre de l’attention et sous les projecteurs comme le petit Doinel des Quatre cents coups (1959) ou Victor dans L’Enfant sauvage (1970), ou bien qu’ils atténuent discrètement par un ton léger et insouciant la gravité des adultes, comme Sabine, dans Jules et Jim (1961), ou Thomas dans La Femme d’à côté (1981), les enfants sont toujours filmés avec la même justesse et le même souci de vérité.

Filmer les enfants est un défi que Truffaut relève dès son deuxième court-métrage, Les Mistons (1957). Cinq gamins, éveillés à la sensualité et avides de tendresse amoureuse, persécutent Bernadette (Bernadette Lafont) et Gérard (Gérard Blain), un jeune couple d’amoureux. La mélancolie et la cruauté se côtoient et sont portées par une incroyable fraîcheur des enfants, qu’ils tirent de leur sens du réalisme, non sans une petite touche charmante de fantaisie. Ce moment intime de l’enfance où rien n’est encore décidé, où tout apparaît comme possible, marque aussi une transition, un passage de l’indétermination à la détermination, tout en conservant une importante part de liberté. C’est en jouant avec celle-ci que les enfants parviennent à prendre forme et à être formés dans un monde qu’ils apprennent à connaître et à créer. Lorsque la caméra de Truffaut se pose sur eux, ce monde revêt un aspect poétique où tout a des airs de première rencontre. « L’enfant est innocence et oubli, un nouveau commencement et un jeu (…), un premier mouvement, un “oui” sacré », écrit Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathoustra. Ce « oui » est une adhésion à l’appel du monde et du possible, prononcée dans un élan naturel de devenir. La poésie naît alors d’elle-même chez Truffaut, comme résultat, et chasse bien vite les excès de complaisance ou de commisération qui peuvent surgir trop facilement de sourires ou de pleurs d’enfants à l’écran. Le naturel l’emporte sur l’artifice et est montré dans toute sa gravité. Dans Les Quatre cents coups, la traversée nocturne de Paris du petit Doinel (Jean-Pierre Léaud), à l’arrière d’un fourgon de police, rythmée par la musique de Georges Delerue alternant entre tonalité majeure et tonalité mineure, est certainement l’une des plus graves du film. Une larme discrète se dessine sur la joue d’Antoine qui, derrière les barreaux, contemple avec mélancolie le défilé lumineux des enseignes des commerces et restaurants parisiens. Si l’enfant est un personnage par essence pathétique auquel le spectateur est rapidement sensibilisé, Truffaut lui préfère parfois sa gravité, ses drames et sa maturité.

Avec les enfants, tout n’est que spontanéité, comme l’illustre la célèbre scène des Quatre cents coups où Antoine Doinel, face caméra, répond aux questions de la psychologue qui se situe en hors-champ. Le réalisateur a laissé à Jean-Pierre Léaud une grande liberté dans ses répliques, ce qui confère à ce passage des allures de documentaire et va dans le sens de la nouveauté que prônait à cette époque la Nouvelle Vague. Les enfants créent un langage qui leur est propre à partir de l’idée générale que Truffaut leur donnait du film, favorisant ainsi leur désir d’autonomie et leur esprit libre et créatif. Ils inventent ainsi un monde que le cinéaste explore dans toute sa richesse et sa complexité, comme en témoigne L’Argent de poche (1976), où des enfants de tous les âges se succèdent en des scènes allant parfois contre toute vraisemblance. Voir le monde avec des yeux d’enfant, ce n’est pas s’enfermer dans une insouciance et une naïveté frivole, semble dire Truffaut. La gravité est toujours présente et il ne s’agit pas de trouver refuge avec les enfants dans l’illusion d’un bonheur fragile, car le pire surgit toujours avec la même violence imprévisible, comme à la fin des Mistons, de Jules et Jim, de L’Homme qui aimait les femmes (1977) ou encore de La Femme d’à côté.

Chez Truffaut, les enfants, comme les adultes, connaissent le malheur. Cependant, ils peinent souvent à le nommer et à se défaire de ce qui les fait souffrir. Alors ils veulent parfois fuir, pour vivre leur vie, comme Antoine Doinel, ou bien ils découvrent, au travers de mises en scène de situations d’apprentissage, que « la vie est dure », mais qu’« elle est belle, puisqu’on y tient tellement », pour reprendre les mots de l’instituteur (Jean-François Stévenin) à la fin de L’Argent de poche, dans un discours étonnant et bouleversant. Aussi les enfants doivent s’endurcir et trouver dans l’éducation et l’enseignement un moyen de réalisation de soi. En ce sens, Truffaut va totalement à contre-courant de la pensée de son temps lorsqu’il tourne L’Enfant sauvage, montrant avec force la valeur émancipatrice de la culture alors que les étudiants clament dans la rue leur colère contre l’école et l’université.
Cette valeur d’émancipation passe d’abord par le langage. L’enfance apparaît comme le moment d’une expérience anté-linguistique qu’il est difficile de se représenter. Victor est resté dans cet état jusqu’à ce que le Docteur Itard (François Truffaut) lui enseigne le langage par mimétisme. Victor formule tout d’abord des sons, non sans difficulté, et a alors accès à un monde nouveau, stimulant son désir d’apprendre, de découvrir et de conquérir un réel qui ne se limite plus à la pure sensation, passant ainsi d’un état passif vécu — Erlebnis —, à une véritable expérience — Erfahrung —. Il n’apprendra qu’un seul mot : « lait ». Le mot a une fonction à la fois sémantique et symbolique et entraîne l’enfant dans un processus d’objectivation progressive, lui faisant abandonner le cri lorsqu’il exprime son envie de boire du lait. Victor est arraché au milieu des signaux pour atteindre un univers de significations. Aussi, le langage, comme faculté linguistique, est à la fois une condition de possibilité de l’expérience et une structure de production de sens. En ce sens, et pour faire correspondre ici la fiction à la pensée de Wittgenstein, le langage est la forme humaine de l’expérience du monde. L’humanité de Victor se retrouve alors dans cet apprentissage du langage, mais aussi dans sa douloureuse découverte du sentiment d’injustice, lorsque le docteur Itard l’enferme dans le cabinet noir alors qu’il a réussi brillamment un exercice, afin de voir s’il saura se révolter. L’enfant sauvage s’insurge, il crie, il pleure. Le voici désormais personne morale et être de langage, et l’expérience du docteur est une réussite.

À ces figures bienveillantes du Docteur Itard ou de l’instituteur de L’Argent de Poche s’oppose radicalement celle de « Petite feuille » (Guy Decomble), l’instituteur autoritaire des Quatre cents coups. « Vous finirez aux galères », dit-il au pauvre Antoine Doinel. Le maître utilise la violence, la domination, et attribue ainsi un destin à l’élève, qui pourra difficilement s’en débarrasser. Antoine a pourtant bien des capacités. Le rôle du bon instituteur serait celui de lui montrer qu’il est capable d’en user à bon escient. Le regard de Petite feuille est plein de mépris, de volonté d’humiliation, ce qui fait perdre à Antoine toute capacité de devenir. Néanmoins, celui-ci ne cède pas aux larmes — Truffaut refusant de montrer les enfants pleurant et criant pour en faire des objets de pitié —, mais il se réfugie dans les romans de Balzac, dans la foule anonyme des rues parisiennes — tout comme l’enfant du sketch de Chabrol, La Muette, dans Paris vu par (1965) —, puis dans la fugue. Ce gamin de Paris idéaliste et obstiné traverse une période difficile de transition, l’adolescence, où les craintes et les angoisses rythment avec pesanteur ses journées, tout comme la jeune fille de Victor Hugo, Adèle (Isabelle Adjani), dans L’histoire d’Adèle H (1975). Truffaut a mis beaucoup de lui-même dans le personnage d’Antoine Doinel et puise dans sa propre enfance pour le façonner. C’est un enfant sans en être un. Sa mère, sorte de Madame Bovary moderne, s’adresse à lui comme à un adulte, en lui rappelant tous les soirs de ne pas oublier les ordures. Elle ne lui fait preuve d’aucune affection et le laisse ainsi grandir et devenir adulte trop vite. « L’adolescence ne laisse un bon souvenir qu’aux adultes ayant mauvaise mémoire », dit Truffaut. Plus tard, Antoine Doinel cherchera toujours l’amour de familles d’adoption qui seraient ses beaux parents. « Moi, j’adore les jeunes filles qui ont des parents gentils », dit-il dans Domicile conjugal (1970). À la fin des Quatre cents coups, après sa longue course effrénée sur la plage en direction de la mer, Antoine se retourne et son regard face caméra semble dire que cette histoire n’est pas terminée et qu’un devenir est possible.

Ce devenir, quel est-il ? La saga Doinel commence en 1959 et s’achève vingt ans plus tard, en 1979 avec L’Amour en fuite. Antoine est un personnage qui reste dans l’enfance, ou plutôt dans la jeunesse. Il n’a jamais été réellement enfant et ne deviendra jamais réellement adulte. Truffaut l’a lui-même qualifié de personnage du XIXe siècle, anachronique et romantique. Il est dans cet entre-deux qui lui donne toute sa liberté et son envie décalée de s’inscrire dans une société ébranlée par la jeunesse révoltée. Il multiplie les petits boulots, dont certains paraissent totalement absurdes, comme lorsqu’il manipule des bateaux en modèles réduits, ce qui n’est pas sans rappeler le métier de Bertrand Morane (Charles Denner) dans L’Homme qui aimait les femmes, ou celui de Bernard Coudray (Gérard Depardieu), dans La Femme d’à côté. De manière générale, les films de Truffaut sont remplis de souvenirs et semblent vouloir apporter une réponse à la fameuse question de Charles Trenet, dont la musique ouvre Baisers volés : « que reste-t-il… ? ». En effet, que reste-t-il de la jeunesse ? Une insouciance bienveillante, une fragilité maladroite, une légèreté qui côtoie la gravité. Les films de Truffaut sont construits comme des trajets, ou, pour reprendre la célèbre formule de Ferrand (François Truffaut) dans La Nuit américaine, ils «avancent comme des trains (…), comme des trains dans la nuit ».
L’enfance ne vieillit pas, mais le regard qui se porte sur elle évolue et prend de la distance. Avec Les Quatre cents coups, Truffaut dit être le frère ainé d’Antoine. Avec L’Enfant sauvage, il est le père de Victor. Enfin, avec L’Argent de poche, il est le grand-père de tous ces enfants. Filmer l’enfance, c’est un moyen pour le cinéaste de lui rester fidèle malgré les tourments qu’elle peut apporter, de transmettre une expérience qui traverse les âges et les époques, et c’est aussi montrer Antoine Doinel grandir, souffrir, aimer et vieillir. Et surtout, « il ne s’agit pas de tourner avec des enfants pour mieux les comprendre, il s’agit de filmer les enfants parce qu’on les aime ».