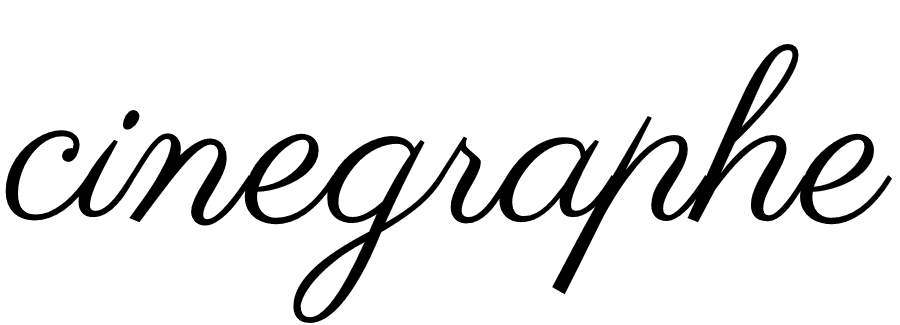Ma rencontre avec Antoine Doinel s’est faite assez tardivement, à l’âge de 17 ans. Je l’ai ensuite suivi de son plus jeune âge dans les 400 Coups jusqu’à sa dernière aventure dans L’Amour en fuite.

J’avais l’impression d’être à bord de ce train qu’évoque François Truffaut dans La Nuit Américaine, ce train avançant droit dans la nuit à toute vitesse, à la destination inconnue. Ensuite, j’ai voyagé vers d’autres univers : Godard, Chabrol, Rivette, Rohmer.
La Nouvelle Vague m’a ouvert les yeux sur le 7ème art et m’a donné envie d’écrire sur le cinéma, et peut-être d’en faire moi-même un jour. J’ai toujours eu un goût pour les images, qu’elles soient immobiles en photographie ou qu’elles se succèdent vingt-quatre fois par seconde. Ecrire sur le cinéma, c’est mêler avec habileté les images et les mots, montrer qu’il y a quelque chose à voir au-delà du simple fait de regarder.
Un film est pour moi l’occasion d’une appréciation esthétique et conduit à une expérience perceptive singulière. Cette expérience, j’aime la transmettre par l’écriture. Plus besoin d’effets spéciaux, d’histoires et de personnages extraordinaires. La beauté est là, dans la simplicité, le banal, l’ordinaire.
On m’a souvent dit que le cinéma d’Eric Rohmer était « vide », « ennuyeux », qu’il n’y avait rien à voir. A première vue, peut-être que l’on ne voit rien. Mais de ce rien naissent une réflexion, une interrogation, un étonnement. Faire « un livre sur rien », c’était le projet de Flaubert avec Madame Bovary. Un film sur rien, c’est déjà quelque chose, une promesse d’ouverture, de contemplation et de plaisir. C’est élargir la vision pour découvrir tous les merveilleux petits détails qui se cachent au sein de la banalité du monde, montrée à l’écran.