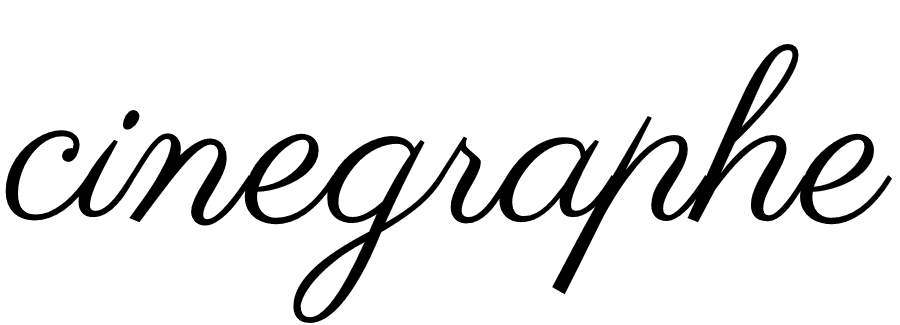Les souvenirs photographiques et oniriques pour retrouver l’oubli
L’Asie a toujours été un continent rêvé et fantasmé par les cinéastes occidentaux, si bien qu’elle apparaît comme un mythe. Chris Marker compte parmi ces artistes japanophiles. Le cinéaste fait du pays du Soleil-Levant un élément récurrent et significatif de plusieurs de ses films, mais aussi écrits et réflexions, afin de répondre à son désir de connaissance et d’entrer pleinement dans un dépaysement spatial et temporel, qu’il appréhende par l’imagination, le rêve et la mémoire.
Chris Marker est un cinéaste du voyage, à la fois spatial et temporel, comme le montre notamment son film La Jetée, fable psychologique sous forme de photomontage. Il exploite dans ce court-métrage de science-fiction futuriste toute la puissance d’image mentale du souvenir. La mémoire rend possible le voyage dans le temps, expérience à la fois douloureuse et fascinante, qui est également au centre de sa pensée sur le Japon.
La même année, Chris Marker publie Le Dépays, livre dans lequel il poursuit sa réflexion sur le Japon, par écrit et toujours en images, de nombreuses photographies en noir et blanc prises à Tokyo accompagnent ses mots. Ce kaléidoscope d’images annonce déjà celui de Tokyo Days, court-métrage de 1988, où Chris Marker retourne à Tokyo, pour y filmer la rue, les passants, et surtout les passantes, guidé un temps par Arielle Dombasle, figure familière et rassurante dans un environnement si inconnu et mystérieux.
Chris Marker apparaît donc comme un cinéaste pour qui le Japon exerce une influence importante, ce dernier étant présent à la fois dans son travail cinématographique et photographique. Comment expliquer cet attrait, ce goût ou plutôt ce désir du Japon ? A travers son travail, Marker parvient, d’une manière singulière, à rendre compte de cette double tension qui existe pour le cinéaste, artiste et voyageur occidental vis-à-vis du Japon, à savoir l’oscillation permanente entre fascination et angoisse, familiarité et étrangeté, mémoire et oubli.
Rêver le Japon pour l’interpréter
Chris Marker contemple le Japon avec les yeux du rêveur. Pour lui, ce pays est un songe, un rêve éveillé, qui mêle des milliers d’images, de lumières, de femmes et de chats. Le Japon de Chris Marker est celui des chats et des jeunes filles, qui sont elles-mêmes comparées à des chats. C’est aussi le pays de l’oubli et des fantômes qui l’accompagnent. « Inventer le Japon est un moyen comme un autre de le connaître », écrit-il en ouverture du Dépays. C’est donc par le rêve et toutes les figures évanescentes qui lui sont associées que l’artiste fait l’expérience de cette terre nippone qui le fascine notamment par son caractère insaisissable. Marker rêve le Japon en même temps qu’il l’interprète, le flux de son esprit fait de la rêverie une fuite en avant, sa posture d’observateur silencieux et attentif transforme son voyage en une immersion progressive dans le pays, qui se laisse voir au travers des yeux de la jeune Koumiko : « Autour d’elle, le Japon », dit-il en commentaire au début du Mystère Koumiko. Petit à petit, le pays se dévoile, accompagnant toujours son imaginaire et sa subjectivité. Marker se fait voyageur rêveur, pour faire de l’image un substitut de la réalité, qui ne relève plus de la simple représentation. Le voyage, qui jusque-là était simplement spatial et linéaire, devient mental et onirique, s’affranchissant des limites imposées par l’espace et le temps, entre sommeil et réveil.
Les Japonais accompagnent le rêve de Chris Marker. Le cinéaste-photographe est à la recherche de ces nombreux mais discrets visages dormeurs des trains qui parcourent la capitale. Le temps du rêve et de l’imaginaire surgit. « Tokyo est une ville parcourue de trains, cousue de fils électriques, elle montre ses veines », écrit-il. Ces trains de couleur le conduisent dans des journées vécues hors du temps, dans un ailleurs, une « zone de silence au milieu du son, d’immobilité au centre du manège ». Le temps s’arrête, et Chris Marker joue ainsi de la nature même du train, qui pourtant est le mouvement même, la fuite, l’insaisissable. L’image rend ainsi compte de la dialectique entre le temps figé et le temps irréversible de la narration, comme une fuite en avant. Prendre en photo ou filmer les voyageurs endormis devient pour lui une activité obsessionnelle, qui répond à cette volonté particulière de créer des liens entre des espaces et des temps éloignés, étrangers. Le train devient le lieu de l’hypnose, tout comme le ferry dans Sans Soleil, où Marker filme les quelques passagers, allongés, endormis, silencieux, en revenant d’Hokkaido. La première image de Tokyo qui suivra sera celle d’un train passant à toute vitesse, dans le quartier de Shibuya. L’objectif de Chris Marker accompagne le mouvement pour en saisir la fixité, l’immuable, le rêve. Ces visages endormis s’insèrent dans la géographie onirique de l’artiste et deviennent le sujet même de son art : « Le train peuplé de dormeurs assemble tous les fragments de rêve, en fait un seul film, le film absolu. Les tickets automatiques deviennent les billets d’entrée », dit la voix-off de Sans soleil. La finalité unique du train n’est plus celle de conduire les passagers d’un point à un autre, mais bien de les faire monter à bord d’un rêve qui est le lieu rare du silence parmi le bruit, de l’immobilité parmi la foule. Le travail de la photographe japonaise contemporaine Mikiko Hara est semblable à celui de Marker, et prolonge la rêverie nippone jusqu’à notre époque. Ce rêve est un film, il file à toute vitesse à travers la capitale japonaise, et rappelle ainsi ce que disait François Truffaut sous les traits du personnage réalisateur Ferrand dans La Nuit américaine : « Les films avancent comme des trains (…). Comme des trains dans la nuit. »

Le pays des femmes et des chats
Les voyageurs endormis peuvent être comparés à des chats qui se déplacent comme dans les songes : « Quelques microsecondes plus tard il était là, sur le balcon, par une de ces compressions de l’espace-temps que les chats sont seuls à connaître ». Au même titre que le passager du train, la figure du chat fascine Chris Marker. Cet animal prend une place particulière dans la vie japonaise. Il est un compagnon fidèle, ou un simple visiteur, un flâneur dans la ville. Les japonais construisent pour eux des cimetières. Leurs maisons, leurs commerces et leurs restaurants sont peuplés de ces petites statues de chats qui saluent, qui semblent indiquer au voyageur intrigué qu’il est ici le bienvenu. Dans Sans soleil, Chris Marker filme des chats immobiles qui saluent dans un temple consacré à l’animal, dans la banlieue de Tokyo, où un couple se rend tous les jours pour prier en mémoire de leur chat disparu. Il n’est peut-être pas mort, mais lorsqu’il le sera, il pourra trouver là le lieu de son repos. Koumiko est aussi fascinée par les chats, en particulier par leur regard : « Il a l’air soupçonneux, et quand je balance mon coeur entre la gentillesse et la méchanceté, sans aucune assurance, je vois le même reflet subtil dans les yeux », dit-elle. Le chat fascine par son regard, un regard qui évoque la femme. « Je vois ma femme en esprit ; son regard, / Comme le tien, aimable bête, / Profond et froid, coupe et fend comme un dard »[1], écrit Baudelaire. Le cinéaste partage avec le poète cette même fascination pour les chats, qui leur évoquent un visage féminin. Dans Tokyo Days, Marker filme Arielle Dombasle dans les rues de Tokyo, avec son regard félin, postée devant une affiche sur laquelle apparaît la photo d’un chat.
Le chat, parce que son regard est une énigme, exprime le mystère, l’altérité et la fascination, tout comme le Japon. Le voyage du rêve est l’occasion d’une expérience d’étrangeté et de dépaysement. Il provoque ainsi la rencontre avec l’autre. La femme est aussi la figure de l’altérité, essentiel au cinéma : « Le cinéma et la femme sont restés comme deux notions inséparables, un film sans femme est comme un opéra sans musique ». Le voyage est une recherche de la compréhension, d’une réponse, donc de mots qu’il faudrait mettre sur une réalité insaisissable pour mieux l’appréhender. Cependant, Chris Marker ne parle pas japonais, c’est pourquoi il ne peut qu’« inventer » ce Japon, pour le connaître. Les portraits de femmes dans le métro ont le visage dur et froid, notamment dans Tokyo Days, et viennent ainsi s’opposer à ceux des femmes souriantes et bienveillantes qui peuplent le rayon alimentation d’un grand magasin. Le Japon est un pays qui se donne à voir mais qui échappe à toute tentative de l’approcher et de le comprendre. Chris Marker demande à Koumiko ce qu’est la « vie japonaise ». Il veut savoir, et s’obstine face aux réponses tautologiques de la jeune femme : « C’est vivre en japonais. C’est vivre au Japon », lui répond Koumiko. « Et… en quoi c’est différent de vivre en France ou en Amérique ? — C’est d’abord… l’air ! — Qu’est-ce qu’il a l’air ? — L’air mouillé… ». La vie japonaise est une vie attentive à la nature contemplative et sensorielle, qui suscite ainsi le rêve et suspend le temps, ce temps qui « est une rivière qui ne coule que la nuit », comme il écrit dans le premier chapitre du Dépays.

Le dépaysement temporel
Malgré l’influente constante des États-Unis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Japon reste très attaché à la tradition. Le pays doit gérer l’émergence d’une culture qui fusionne une esthétique antique de l’éphémère, cette « impermanence des choses » qui est l’inspiration des poètes classiques japonais, avec une modernisation accélérée. Il s’agit ainsi pour Chris Marker de scruter les moindres détails de la mégalopole japonaise, ultra moderne, aux allures futuristes, notamment la nuit, illuminée dans une forêt de néons aux couleurs électriques. Rappelons par ailleurs que la première fois que Marker se rend au Japon, pour les JO de 1964, le pays veut exhiber une nouvelle figure, moderne et modernisée, au paysage renouvelé et au mode de vie de plus en plus occidentalisé. « Un Japon peut en cacher un autre », écrit-il dans Le Dépays. La ville se transforme, elle laisse place aux immenses immeubles qui viennent rendre si précieux et charmants les petits quartiers qui portent encore les souvenirs d’un autre temps. La diversité architecturale fascine Marker : « chaque quartier de Tokyo devient une petite bourgade, naïve et proprette, qui se cache entre les pattes des gratte-ciels ». La tradition perpétue un mode de vie dont les normes et la pensée sont véhiculées et transmises par les deux religions majoritaires au Japon, le bouddhisme et le shintoïsme. Chris Marker filme des cérémonies traditionnelles dans les temples et les sanctuaires, notamment dans Le Mystère Koumiko, ainsi que les matsuri, ces « fêtes de quartier » imprégnées de tradition. Leur scénographie particulière laisse toute sa place au mouvement, porté par la danse et les chants, mais aussi les costumes colorés et les lumières. Le rythme de la musique traditionnelle japonaise accompagne les prises de vue du cinéaste. Il se place au plus près des danseuses, pour rendre compte de la légèreté de leurs mouvements, de leur parfait équilibre. Le corps est comme soustrait à toute pesanteur, libéré du poids social et historique, s’inscrivant dans une tradition inébranlable.
Le passé traditionnel côtoie avec harmonie la modernité soudaine du pays, notamment à partir des années 1960. Les téléphones fleurissent dans les rues, les photographes déambulent, à la recherche de sujets insolites et neufs, se mêlant ainsi aux cireurs de chaussures et arpentant les étalages des marchés ouverts. L’occident se fait petit à petit une place au Japon, notamment dans la mode : les mannequins japonaises sont occidentalisées, elles ont un visage européen, des cheveux clairs. De plus en plus, les femmes japonaises recourent à la chirurgie esthétique pour leur ressembler, ce qui fait notamment dire à Koumiko que son visage, très asiatique, n’est « plus à la mode ». Cependant, le Japon qui se modernise ne plait pas à tous : des japonais protestent contre la construction de l’aéroport de Narita, qui est aujourd’hui le plus grand aéroport du Japon.
Oublier la mémoire
Le pays veut montrer qu’il a évolué depuis la fin de la guerre. Sa capitale est nouvelle, les reconstructions sont achevées, le miracle économique bat son plein. Dès la fin des années 1960, le Japon se hisse au rang de deuxième puissance mondiale. La télévision importe de nouveaux idéaux, les images médiatiques fusent, leur mouvement accompagne celui des affiches publicitaires et des manga, dont les personnages sont parfois dessinés sur les murs. « Toute la ville est une bande dessinée », dit le commentaire de Sans soleil. La ville devient alors une véritable topographie de la mémoire, pour se déplacer dans le temps. « Ne pas s’orienter dans une ville ne signifie pas grand-chose, mais se perdre dans une ville demande tout un apprentissage », écrit Walter Benjamin. Chris Marker est ce flâneur silencieux et observateur d’un monde qu’il ne comprend que par l’imaginaire et le rêve, à la recherche d’un passé qui paraît s’effacer petit à petit. Le Japon tente d’oublier un passé douloureux, celui de l’occupation de la Corée et de la Seconde Guerre mondiale. Le cinéaste médite ainsi sur la nature des images, à la fois mémoire et traces de l’histoire d’un pays, d’un peuple.
La mémoire historique est celle de la guerre, dont les Japonais sont incapables de parler et de se souvenir, comme le fait notamment comprendre à travers ses films le réalisateur japonais Nagisa Oshima à cette époque, en particulier dans A propos des chansons paillardes au Japon, sorti en 1967. Oshima fait ainsi le portrait d’une jeune génération qui n’a pas connu la guerre, mais qui est sans cesse confrontée à son douloureux souvenir et qui préfère trouver refuge dans l’amnésie. Cependant, le fantôme de la guerre hante les esprits et les familles. Cette névrose historique se manifeste notamment dans la reconstruction, très rapide, de la capitale, qui fait naître une ville totalement nouvelle et méconnaissable. Il s’agit d’effacer toutes les traces de la guerre, de renaître en oubliant les crimes et heurts passés, mais aussi en occultant toute une partie de l’histoire que le pays refuse, où la culpabilité et la honte côtoient la victimisation et la peine. Dès lors, les voyageurs endormis du train prennent une autre signification. Le sommeil collectif les fait tomber dans un songe illusoire, celui où le passé n’existe plus, ou plutôt ne doit plus exister. Seul le présent et l’avenir comptent, prometteurs, heureux et japonais. Lorsque Chris Marker demande à Koumiko ce qu’elle pense des actualités mondiales, celle-ci est embarrassée car ne sait que répondre, pour la simple et bonne raison qu’elle ignore tout de ses nouvelles venues d’un monde qui pour elle est si lointain. Son indifférence se mêle à sa candeur, et pour elle, ce qui se passe ailleurs, « c’est comme les vagues de la mer, ça vient ». Sa formule sera reprise ensuite par Marker, qui réfléchit sur le sens des évènements et leur impact vis-à-vis de ceux qui ne les vivent pas, mais ne peuvent les appréhender que par les images ou les journaux : « Mais bientôt, ils arriveront, les résultats des événements. C’est comme la vague de la mer, une fois qu’il arrive un tremblement de terre, même si c’est un accident lointain, la vague avance peu à peu et cela finit par arriver jusque à moi. »[2] Les images sont alors pour Marker le moyen de montrer ce passé qui sommeille, à la recherche de « petits fragments de guerre », comme il est dit dans Sans soleil. Elles indiquent avant tout un processus temporel. Il questionne ainsi le rapport de la société japonaise au passé, afin de confronter sa mémoire et son propre imaginaire à une mémoire collective fondée sur l’oubli.

Se souvenir de l’oubli
C’est dans la forme même de ses travaux que Chris Marker trouve des réponses à son interrogation première concernant le Japon : comment comprendre le pays, comment parvenir à savoir ce qu’est la vie japonaise, ce qu’est être japonais ? Autrement dit, comment atteindre l’insaisissable, l’altérité ? Pour parler du Japon, Marker se dédouble, il place les images à distance, qui deviennent ainsi des souvenirs. Dans Sans soleil, le mystérieux personnage fictif Sandor Krasna envoie ses lettres qui sont des comptes-rendus de voyage à la jeune femme au ton neutre qui les lit et commente en voix-off, jouée par Florence Delay, introduisant toujours ses mots avec cette fameuse formule : « il m’écrivait … ». En réalité, Sandor Krasna est un nom derrière lequel se cache le réalisateur, et ses lettres sont les siennes. Le voici donc recourant au double rendu possible par la fiction épistolaire, afin de figer sa mémoire subjective : « Je me souviens de ce mois de janvier à Tokyo ou plutôt je me souviens des images que j’ai filmées ce mois de janvier à Tokyo. Elles se sont substituées maintenant à ma mémoire », lit la voix. Marker se demande comment les souvenirs peuvent subsister sans la photographie, et comment la photographie peut se substituer aux souvenirs comme images mentales, pour devenir des images imprimées et photographiques. La photographie fige l’objet, elle vient arrêter le temps dans les innombrables variations insaisissables des paysages et des visages.
La photographie et l’image deviennent le support du rêve, pour créer une mémoire dépourvue de souvenirs subjectifs, mais qui est toujours actualisée par l’objectif de l’appareil photo. En ce sens, Marker fait du cinéma la « mémoire du temps non vécu »[3], tout comme la télévision est pour lui une « boite à souvenirs ». Il réécrit la mémoire tout en essayant de retrouver celle du Japon. Sa quête est celle du devenir et non de l’être. Les images lui permettent de parvenir à se souvenir de sensations, d’envies, de désirs et de craintes, que le commentaire exprime. Le voyage est son propre imaginaire, dans lequel il continue de se cacher sous les traits d’un autre. Dans Le dépays, Marker utilise le « tu », qui marque ainsi une frontière entre la temporalité de la flânerie tokyoïte et la temporalité de l’écriture. En effet, les photographies qui illustrent le livre datent de septembre à janvier 1981, le texte date de 1982 et est écrit en France. Chris Marker n’est pas le même en France et au Japon : « Mais je sais que, si je retourne demain au Japon, j’y retrouverai l’autre, j’y serai l’autre », écrit-il. Le voyage permet ainsi la rencontre paradoxale de son autre propre, de cette altérité qui est finalement soi-même, qui émane de soi-même. Le dédoublement permet de mieux appréhender un pays dont les règles, les coutumes et les temps échappent au voyageur, qui ne peut les comprendre que par le rêve, l’imaginaire. La phrase d’ouverture du Dépays prend alors ici tout son sens.
C’est bien en inventant le Japon que Marker parvient à le comprendre, du fait même de son caractère insaisissable et mouvant. La réalité et l’univers fantasmatique se confrontent et la frontière entre le présent et le passé s’annule. L’ubiquité de l’auteur pose ainsi la question de l’image, en lien avec la fuite, les fantômes et les morts. La réflexion que Marker propose ici, à travers ses clichés photographiques, notamment dans les trains de Tokyo, n’est pas loin de celle de La Jetée, qui met aussi en scène un homme qui voyage, dans le temps. La forme du film donne à l’image fixe un aspect spectral. Barthes, dans La Chambre claire, rend compte de sa volonté d’« entourer de (s)es propres bras ce qui est mort, ce qui va mourir », avec la photographie. L’image peut contenir toute la vie d’un homme, jusqu’à sa mort, en la condensant dans une image-photographie. Barthes poursuit sa réflexion en distinguant dans l’image photo le « studium » — renseignements qu’elle transmet, significations qu’elle accueille — et le « punctum », le « ça a été », comme présence sensible brute qui affecte sans signifier. L’importance pour Barthes est la poétisation de l’image et sa valeur esthétique est avant tout située dans la conjonction de son affirmation formelle et de sa valeur signifiante. L’image doit donc se risquer à ne plus être la simple représentation de quelque chose, pour ouvrir en elle un nouveau mode de présence à l’apparaître et au sens. C’est dans les images mentales du voyageur photographe, qui par son regard s’ouvre à un nouveau monde et une nouvelle temporalité, que le film naît et se déroule, en faisant paradoxalement apparaître l’horizon de la fuite et de la mort. L’image primitive est diffractée et va être ensuite réécrite par le commentaire, pour former d’autres images, d’autres rêves, et Marker confronte ainsi en permanence les faits et le récit, le documentaire et la fiction, jouant avec les frontières indécises des formes cinématographiques et photographiques.
La fascination de Chris Marker pour le Japon répond à un désir particulier, celui de se confronter à l’altérité et de prolonger la rêverie, en questionnant la mémoire individuelle et collective. Mathieu Capel parle de la « chose Japon »[4] qui est pour Marker non pas le simple objet d’une curiosité, mais véritablement « une érotique »[5].
Marker est
motivé par l’élan d’une rencontre vers l’autre, le lointain,
l’incompréhensible, qui pourtant se laisse parfois approcher et saisir, dans
toute son étrangeté, pour laisser place au rêve et à l’imaginaire que le cinéma
et la photographie permettent de faire naître.
[1] Charles Baudelaire, « Le Chat », Les Fleurs du mal, 1857.
[2] Chris Marker, Commentaires 2, Seuil, 1967, p.36.
[3] Jean-Louis Schefer, Images mobiles, POL, 1999, p.87.
[4] Mathieu Capel, L’érotique Japon.
[5]Ibid.