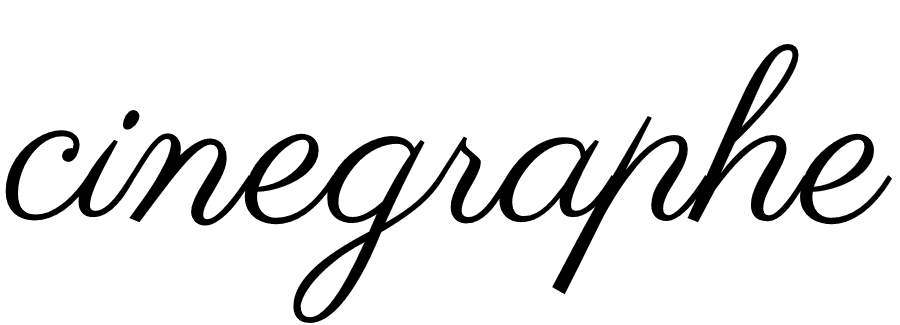Songes et mensonges, partir ensemble, odeur de menthe, de belles attentes…
Le réalisateur polonais Jerzy Skolimowski réunit dans un film quelque peu oublié aujourd’hui Jean-Pierre Léaud et Catherine Duport, que le spectateur avait déjà pu voir dans Masculin Féminin de Jean-Luc Godard. Le Départ arrive plus tardivement par rapport aux autres films qui marquent le début de la Nouvelle Vague en France, comme Les Quatre-Cents Coups (1959), ou A bout de souffle (1960), mais n’offre pas moins d’énergie et de vie, toutes deux portées par la jeunesse des années 1960.
À l’époque de la sortie du film en 1967, la Nouvelle Vague a déjà établi et illustré ses critères esthétiques et poétiques, qui ne sont plus nouveaux, mais bien connus du public. C’est pourquoi il n’avait rien de véritablement révolutionnaire ou novateur, et sa grande liberté, tant technique qu’au niveau du montage et de la composition, n’était pas regardée comme telle. Et pourtant, le film est incroyablement réussi, son rythme haletant est épatant, le spectateur est convié à bord d’un bolide lancé dans une course folle et fougueuse. La vitesse est sûrement ce qui caractérise en premier le quatrième long-métrage du réalisateur polonais. L’histoire est simple : Marc (Jean-Pierre Léaud), garçon coiffeur passionné de voitures, veut courir un rallye avec une Porsche, qu’il ne possède pas, mais qu’il compte emprunter à son patron. Cependant, ce dernier décide de partir en week-end, et Marc va devoir se procurer la voiture de ses rêves d’une autre manière. Au cours de ses livraisons de perruques qui se transforment en de drôles aventures à travers la capitale belge, à peine reconnaissable, Marc rencontre Michèle (Catherine Duport), une jeune fille de bonne famille qui l’aidera dans sa quête.
Il est difficile de ne pas voir le personnage de Marc comme un prolongement du petit Antoine Doinel découvert dans Les Quatre-Cents Coups de François Truffaut, et qui est devenu adolescent dans Antoine et Colette. La « fougue d’Antoine » — premier titre envisagé pour le sketch de Truffaut — pourrait ici être celle de Marc, porteur d’une insidieuse légèreté et d’une grande délicatesse qui se mêlent à un propos plus grave sur un monde en pleine mutation sociale et tourné de plus en plus vers la société de consommation et la publicité.
La jeunesse en est la cible première. Les jeunes couples doivent posséder une automobile, cette invention devenue un mythe comme l’écrit Roland Barthes une dizaine d’années avant la sortie du film, dans Mythologies : « Je crois que l’automobile est aujourd’hui l’équivalent assez exact des grandes cathédrales gothiques : je veux dire une grande création d’époque, conçue passionnément par des artistes inconnus, consommée dans son image, sinon dans son usage, par un peuple entier qui s’approprie en elle un objet parfaitement magique. » Et cela, le réalisateur le montre bien. Marc veut une voiture, non pas pour le fait d’en posséder une et pour son utilisation pratique, mais bien pour se faire voir avec, pour séduire Michèle, pour faire l’expérience de la vitesse, autrement dit pour affirmer son désir impétueux d’aller au-delà du possible et de toujours persévérer dans sa jeunesse. D’où l’aspect « magique » de la voiture. Elle procure à Marc un sentiment d’immortalité, de course infinie, que le spectateur éprouve lui-même lorsque la caméra filme au plus près la route défilant sous le pneu de la voiture lancée à toute allure. Outre la vitesse qu’elle offre, l’automobile est aussi un signe extérieur de richesse à la fin des années 1960, elle devient un symbole de la course au confort et au loisir. Il faut en posséder une pour être heureux, semble indiquer l’immense panneau publicitaire pour Simca, sous lequel se battent Marc et un automobiliste après un léger accident. C’est notamment dans cette scène que la liberté du jeu des acteurs et du travail de l’équipe technique se ressent. La bagarre est improvisée, et Willy Kurant, ancien cadreur d’actualités et chef opérateur de Masculin Féminin de Godard, suit leurs mouvements caméra à l’épaule pour être tout proche de l’action. Le montage est rapide et sec, les plans s’enchaînent au rythme des coups donnés par l’un ou par l’autre.

Cette virtuosité technique témoigne également de l’influence de la Nouvelle Vague sur le réalisateur. Beaucoup de plans sont tournés en extérieur, la caméra joue avec les différentes prises de vue, et la narration ne suit pas un schéma classique. Les scènes s’enchaînent sans réelle coordination et le réalisateur se sert avant tout de ce que la réalité lui offre. Par exemple, il n’était pas prévu que le miroir transporté dans la rue par Marc et Michèle se brise, mais il suffisait d’inverser l’image pour en recoller les morceaux. Aussi, une grande place est laissée à l’improvisation, et les idées viennent parfois sur le vif, notamment de la part de Jean-Pierre Léaud. Celui-ci a même changé son texte lors de la postsynchronisation. Cette fantaisie spontanée permet de mêler les genres. Les scènes du salon de l’automobile bondé ou du défilé des filles en maillot de bain au bord de la piscine rappellent le cinéma-vérité, celles entre Marc et Michèle évoquent parfois la comédie musicale et leur rythme plus lent marque une pause dans l’action et construit un contrepoint par rapport au reste. Le temps semble ainsi se figer soudainement lorsqu’ils se retrouvent tous les deux la nuit au salon de l’automobile. Ils prennent place dans une voiture exposée, coupée en deux, qui tourne. En silence, ils se regardent, s’éloignent et se rejoignent. La narration s’arrête et la douce voix de Christine Legrand, chanteuse de certains films de Jacques Demy, vient prendre le relais.
Cette belle chanson au ton langoureux et mélancolique est d’autant plus surprenante qu’elle s’insère dans une bande-son fortement marquée par le jazz énergique quasiment omniprésent tout au long du film. La musique est composée par Krzysztof Komeda, à qui le réalisateur avait montré une première version du Départ en lui donnant quelques indications sur les sons et les émotions. La partition de Komeda inscrit pleinement le film dans la modernité. Comme dans A Bout de Souffle, ou encore Le Signe du Lion d’Éric Rohmer, la musique a une fonction à la fois performative et révélatrice, et plus encore, elle trouve la justification de son utilisation dans le film lui-même. Le free jazz accompagne l’image à merveille et renforce par son rythme saccadé sa vitesse et son idée de fuite en avant. Il s’agit pour le compositeur de parvenir à faire entendre des univers musicaux distincts, sans qu’un thème bien précis soit perceptible, mais en restant toujours du côté du mouvement, d’une force immense maîtrisée qui se propage à travers tout l’écran et qui se retrouve dans chaque plan. La musique n’est pas un vulgaire « papier peint », mais elle a une grande valeur narrative, comme chez Truffaut ou Godard. Elle recouvre parfois toute la bande-son et le film bascule alors dans le cinéma muet, tant le jeu physique des acteurs, et notamment de Jean-Pierre Léaud, l’emporte sur la parole.

La musique, la liberté, la jeunesse et l’improvisation sont autant d’éléments qui permettent de raccrocher ce film au courant de la Nouvelle Vague, malgré sa sortie tardive. Le propos du film évolue vers une fin ouverte, qui laisse penser que Marc a grandi et qu’il entre maintenant pleinement dans l’âge adulte, son image d’enfant agité et naïf brûlant comme la photographie de Michèle petite.
Cette influence de la Nouvelle Vague chez Skolimowski se retrouve et se confirme trois ans plus tard, avec Deep End, sorti en 1970. Les couleurs et le traitement de l’espace rappellent Godard. Le personnage de Mike n’est pas très loin de l’Antoine Doinel adolescent. Toujours cette fascination pour la musique et le rythme, avec Cat Stevens qui accompagne le trajet à bicyclette de Mike le long des rues désertes et grises d’une banlieue londonienne en ouverture. Un film à voir, ou à revoir, tout comme Le Départ.