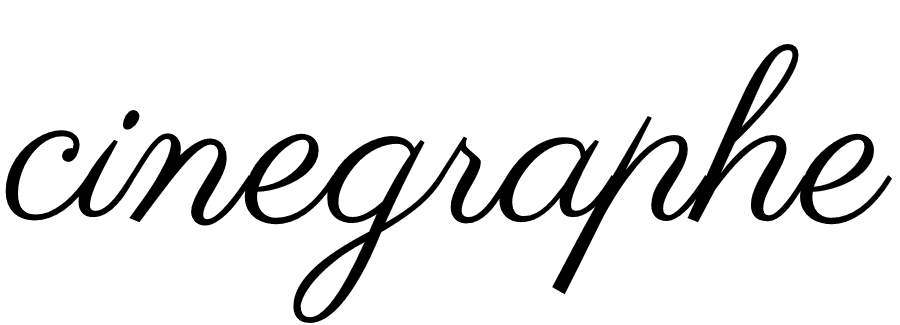Mieux vaut une tête bien faite qu’une tête bien pleine
Qu’est-ce que la mauvaise éducation ? La réponse à cette question pourrait se trouver dans ce court-métrage d’Éric Rohmer sorti en 1958, qui illustre le caractère vain d’un apprentissage par cœur et mimétique. La jeune et belle Véronique (Nicole Berger) a bien du mal avec le petit Jean-Christophe (Alain Delrieu), pour qui les leçons particulières de mathématiques et de rédaction française deviennent de longs moments de tâtonnements, rythmés par les « j’sais pas » de l’élève, mais aussi de la professeur.
Derrière l’apparente simplicité de ce film de 20 minutes se cache une structure complexe à la construction dramatique élaborée. La mise en scène est marquée par deux éléments essentiels, qui se retrouveront par la suite dans toute l’œuvre de Rohmer, à savoir la rigueur du récit et le sens du cadrage. Cette scène de la vie de tous les jours, qui pourrait plutôt relever de l’anecdote, se fonde sur un jeu d’opposition très net entre l’enfant, énergique et agité, et la jeune professeur, rigoureuse et droite, dont le tailleur à carreaux n’est d’ailleurs pas sans rappeler le carrelage du sol de la chambre assez austère. On y trouve quelques tableaux sur les murs, deux ou trois meubles, une table ronde sur laquelle Véronique et Jean-Christophe travaillent — ou du moins, tentent de travailler — ainsi qu’un grand piano à queue au milieu de la pièce. Si le décor paraît au début beaucoup trop chargé, il tend à se faire de moins en moins visible au fur et à mesure de la leçon. La caméra se resserre petit à petit pour se concentrer sur les deux principaux protagonistes, qui sont alors au centre de la narration.

L’image et la narration tendent à renforcer l’aspect scolaire, cadré et équilibré du film, divisé en deux parties égales : la première, de jour, traite des mathématiques, la seconde, de nuit, de la rédaction française. Les quelques entrées et sorties presque théâtrales de la mère du petit Jean-Christophe, rythmées par le même « Je sors ! » mélodieux et impertinent, qui laisse deviner des retrouvailles avec un amant, ont pour simple fonction de marquer le passage d’une scène à l’autre. Dès le début, le jeu des masques se fait voir. En présence de son fils, la mère est autoritaire et exaspérée. Mais dès que Véronique entre dans la pièce, elle devient douce et tranquille, abusant des formules de politesse. Le dialogue soutenu entre les deux femmes s’accorde parfaitement avec l’intérieur bourgeois. Jean-Christophe a immédiatement démasqué leur ton forcé et faussement modeste lorsqu’il s’amuse à caricaturer leurs paroles en les reprenant silencieusement avec de jolies grimaces. Il essaie d’exister parmi ces grandes personnes qui ne cessent d’endosser des rôles différents et qui finissent par oublier qu’il est bien là, qu’il est présent. « Plus il grandit, plus il devient bête », dit la mère de Jean-Christophe à Véronique alors même que celui-ci est à ses côtés. En effet, devenir adulte s’accompagne d’un abandon à la bêtise et à l’éclatement de l’identité. Jean-Christophe reste lui-même, un gamin joyeux et vif, contrairement à Véronique qui ne fait que jouer le rôle de professeur. Si son visage, son attitude et ses paroles traduisent une volonté de rigueur et de sérieux, ses jambes disent tout autre chose. Plusieurs fois, la caméra invite le spectateur à jeter un coup d’œil à ce qui se passe sous la table : Véronique retire ses chaussures et joue avec ses pieds. Là voici donc divisée — à l’image des fractions que Jean-Christophe tente de multiplier sur son ardoise — coupée en deux par la caméra, qui montre qu’en réalité, l’esprit de Véronique est ailleurs, à la rêverie.

Impossible donc d’enseigner quoique ce soit ici : l’élève ne comprend pas et la professeur aimerait sûrement être ailleurs. La tentative est vaine de plier l’enfant à la discipline. Dès le début, le spectateur se doute qu’il sera victorieux — contrairement à ce que pourrait sous-entendre le prénom même de Véronique, qui en grec signifie « qui porte la victoire », de l’infinitif pherein (porter) et nikè (victoire) —, la musique de la comptine qui accompagne le générique appelant directement le motif de l’enfance avant même que Jean-Christophe apparaisse à l’écran. Cette musique revient pour clôturer le film, évoquant ainsi par son caractère cyclique l’inutilité et l’inefficacité des exercices et de l’enseignement de Véronique et marquant le retour à l’amusement, qui finalement était toujours présent. Jean-Christophe n’a fait que répéter bêtement des formules mathématiques sans réussir à les mettre en pratique. Or, « savoir par cœur n’est pas savoir », comme l’écrit Montaigne dans « De l’institution des enfants », dans le premier livre des Essais. L’enfant ne fait ici que tomber dans du pur psittacisme, ce qui ne l’aide nullement à comprendre l’exercice. Cette tendance à répéter des paroles toutes faites était manifeste dès le début : lorsque Jean-Christophe salue Véronique, il ne fait que reprendre les mots de sa mère. Il les répétera encore à la fin, lorsqu’il annonce à Véronique que la leçon est terminée et qu’il est l’heure de partir. Il reste très pragmatique. La rédaction française est pourtant simple : « C’est jeudi. Vous vous levez et vous pensez à ce que vous allez faire cet après-midi ». Mais impossible pour lui d’écrire plus de deux lignes. Décidément, cet enfant n’est pas rêveur. C’est d’ailleurs ce qui le différencie d’Antoine Doinel, habité par un seul désir, celui d’indépendance. Il veut partir et vivre sa vie, sans subir l’autorité de sa mère ou du maître d’école.

L’enfant se situe toujours du côté de la spontanéité, de l’immédiat, de l’instant. Il est donc difficile pour lui de penser à ce qu’il fera plus tard. Il pense qu’il ira patiner jeudi. « Et comment y pensez-vous ? » lui demande Véronique. « Bah, en y pensant ! », répond-il. Il est question ici du simple fait de penser, et non de la manière de penser ou du contenu de la pensée. Jean-Christophe est dans l’action, dans le fait. Alors, il imite le mouvement du patineur. Cette question de la manière de penser en soulève une autre plus large : comment parvenir à saisir la pensée, la pensée en train de se faire ? Jean-Christophe est incapable de se considérer comme objet, incapable d’analyser sa propre pensée et perçoit le monde sous la forme de l’intuition. Il n’a finalement qu’une seule envie, celle de retourner jouer avec son ballon, en attendant que sa mère rentre. Véronique s’y prend donc bien mal avec son petit élève. La méthode est pourtant simple : apprendre à penser est le précepte premier, si l’on se réfère de nouveau à Montaigne. Et pourtant, le fait de devoir penser est une contrainte pour l’enfant. Ne penser à rien lui suffit à être heureux. Ici, il ne s’agit pas de ne pas penser, mais bien de ne penser à rien. C’est un thème que l’on retrouvera à plusieurs reprises dans l’œuvre de Rohmer, notamment dans La Femme de l’aviateur, avec ce sous-titre « On ne saurait penser à rien », ou encore dans La Collectionneuse, où le personnage d’Adrien est à la recherche du rien absolu.
C’est donc dans ce court-métrage d’une apparente simplicité que Rohmer, ancien professeur, impose à l’anecdote un sens précis, sans lourdeur didactique. La « tête bien faite » s’acquiert selon une méthode fondée sur une réflexion intellectuelle, morale et pragmatique. L’enfant, en se confrontant au monde et en se situant en permanence du côté de la spontanéité et de l’instant, parvient à forger sa personnalité. Jean-Christophe n’est pas un cancre, mais plutôt un jeune héros oisif, qui préfère ne pas travailler plutôt que de ne travailler pour rien.