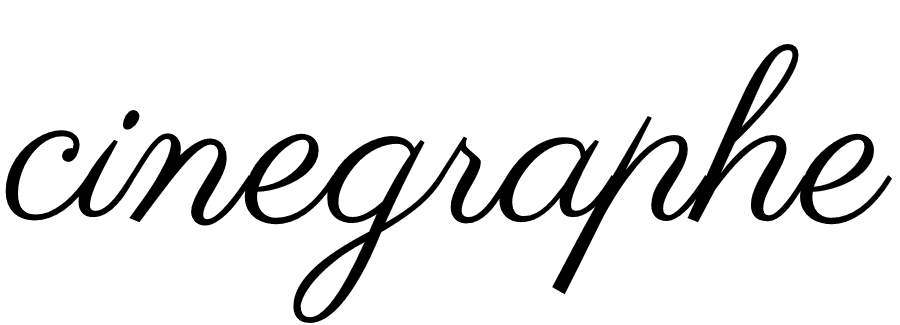Deux regards de cinéastes sur la jeunesse des années 1960
La Nouvelle Vague se fonde sur une rupture à la fois technique et esthétique. Le réalisateur français Jean-Luc Godard et le japonais Nagisa Oshima, dès le début des années 1960, bousculent les codes cinématographiques préétablis et font de la jeunesse le sujet principal et le premier destinataire de leurs films. Cette jeunesse s’inscrit dans une époque où partout se lit une volonté d’indépendance et d’émancipation. Le cinéma devient alors le reflet du temps et de la pensée.
En 1960, pendant que Godard filme A bout de souffle, qui s’imposera vite comme le manifeste esthétique du mouvement de la Nouvelle Vague en France, Oshima lance les prémices de ce nouveau courant au Japon avec ses Contes cruels de la jeunesse —青春残酷物語 —.

Les deux réalisateurs affirment leur volonté particulière de faire du cinéma un art du temps. La continuité tranquille et sans embuche qui faisait avancer le film jusqu’au fameux mot « fin » est rejetée par le jeu de la fraction, de la rupture et de l’immédiateté. La Nouvelle Vague réintroduit le discontinu et se dispense de travailler le futur pour réfléchir sur le présent et l’instant. Godard et Oshima explorent de nouvelles pistes d’expression visuelle et affirment ainsi leur modernité. Dès lors, leur parti pris esthétique cinématographique se fonde essentiellement sur des gros plans de visages morcelés qui apparaissent au fur et à mesure et se dessinent en totalité dans la tête du spectateur. Les scènes s’enchaînent avec rapidité, dans la rue, dont les dimensions et la beauté sont mises en valeur par les travellings. La vie ordinaire est filmée avec spontanéité, guidée par la musique de Martin Solal dans A bout de souffle, qui accompagne notamment les deux jeunes protagonistes lors de leurs allées et venues sur les Champs-Élysées. Chez Oshima, le rythme endiablé de la musique rock vient marteler les escapades nocturnes des amants, Makoto — Miyuki Kuwano — et Kiyoshi — Yusuke Kawazu — roulant à toute vitesse sur une moto dans les rues de Tokyo et souligne régulièrement les moments de tension, d’une manière saccadée, contrastant ainsi avec les quelques morceaux de Beethoven écoutés dans leur petit appartement miteux.
Ces scènes intimes du couple tokyoïte ne sont pas sans rappeler celles de Michel Poiccard — Jean Paul Belmondo — et Patricia Franchini — Jean Seberg — dans leur studio parisien au matin, dont l’étreinte est rythmée tantôt par un jazz sensuel, tantôt par les bruits de la rue.

La nouvelle gestion de la durée s’accompagne de ce retour au naturel et à l’ordinaire et met ainsi la grammaire traditionnelle cinématographique à mort, en tournant le dos au cinéma narratif. L’improvisation — surtout chez Godard — et le documentaire mariés au spectacle dictent les nouveaux codes esthétiques de ce cinéma moderne. La mise en scène se veut révolutionnaire par son souci d’économie, sa grande sobriété, ses éclairages naturels et par l’usage répété du plan séquence et du faux raccord volontaire. La caméra portée, les très gros plans, la réalisation nerveuse et énergique, ou encore les extérieurs naturels et les intérieurs étroits sont autant d’éléments qui participent de cette recherche d’une manière novatrice de faire du cinéma, de voir le temps et d’en rendre compte.
Filmer la jeunesse devient alors un gage de modernité. Godard et Oshima dressent le portrait d’une seule et même génération, celle de la jeunesse des années 1960, caractérisée par son goût pour la rébellion. Michel Poiccard et Kiyoshi passent de la figure du voyou sympathique au héros moderne, ordinaire et banal, filmé de dos, souvent noyé dans l’agitation des rues parisiennes ou tokyoïtes. La même jeunesse se perd d’un bout du monde à l’autre. Indocile, elle reste insatisfaite et se livre à des expériences amoureuses et érotiques apparemment désespérées, mais qui révèlent son rêve d’indépendance et son aspiration à la liberté . Les deux films montrent à l’écran une histoire d’amour passionnée et tragique, qui pourrait se résumer ainsi : la jolie fille tombe sous le charme du vilain garçon, et ça se termine mal. Les amants sont seuls face à eux-mêmes dans un monde où les normes se cassent la figure. Au Japon, la rupture générationnelle se lit dans la culpabilité des parents qui n’ont rien à offrir à leurs enfants et renoncent à perpétuer les traditions. Les jeunes semblent être portés par une force impatiente qui les conduit à s’abandonner à une passion destructrice et à l’oisiveté d’un univers sans foi ni loi. L’autorité est sans cesse défiée : celle des pères, celle de l’État, de l’école. Dans A bout de souffle, Michel ne laisse aucun obstacle entraver sa liberté. De voleur de voiture, il devient un meurtrier lorsqu’il tue un policier, ce qui le conduira inéluctablement à être abattu par ses poursuivants, après une course effrénée dans la rue.

La révolte s’exprime avant tout par le corps. Les amants jettent leurs corps gracieux, jeunes et forts à la figure des vieux regards, sans aucune pudeur. Leur bonheur repose sur la consommation voluptueuse à laquelle ils s’adonnent, dans une même idée d’anarchie sexuelle populaire qui a pour seul but l’effondrement de la morale établie. Il n’est donc plus question de moralisation, mais l’amoralité règne. Chez Oshima comme chez Godard, les corps se dévoilent, se touchent, s’étreignent, se battent. Comme l’indique le titre anglais du film du réalisateur japonais (Naked Youth), les personnages montrent leurs corps nus et le sexe est un enjeu important. La sensualité se mêle à la rudesse, la relation est autant passionnelle que destructrice, ce qui confère au film sa tonalité tragique. La première rencontre entre Makoto et Kiyoshi est représentative du film. Il vient à son secours alors qu’elle est agressée par un homme qui la raccompagnait en voiture, tard dans la nuit. Les plans s’enchaînent vite, les deux hommes se battent. La violence devient une glorification du corps jeune et fort et se retrouve plus tard dans les scènes d’amour. Les gifles et les coups accompagnent les ébats amoureux qui précèdent la tendresse des corps fatigués et calmes, dévoilés petit à petit par le travelling.

Cette violence vient alors ternir l’image idyllique des quelques scènes intimes de tranquillité et d’insouciante légèreté. Le bonheur n’est qu’un mensonge veillant à dissimuler le mal-être profond des jeunes et leur incapacité à avoir prise sur le réel et sur le déroulement de leur vie.
Dans les deux cas, le parallélisme entre l’érotisme et la violence politique est saisissant. La rébellion des personnages semble être dénuée de cause et sans but précis. Tous expriment à leur manière un rejet primaire et adolescent envers les codes sociaux et politiques, sans trouver de réelle motivation à leur action. Dès le début des années 1960, les étudiants japonais se soulèvent au côté de la gauche contre le Traité de coopération mutuelle et de sécurité entre les États-Unis et le Japon. Oshima intègre des images d’archive pour immortaliser le moment. Makoto et Kiyoshi deviennent alors la métaphore de toute une jeunesse japonaise désœuvrée, qui veut briser les tabous. Les années 1950 sont marquées par la fin de l’occupation américaine, par de grands mouvements sociaux et étudiants, une urbanisation massive autour de Tokyo et une phase d’expansion industrielle, technique, économique et démographique accélérée. C’est dans ce monde d’après-guerre qu’ont grandi les deux amants.
À la même époque, la France est en pleine guerre d’Algérie et la période de décolonisation s’accélère depuis 1954 avec la victoire des Vietnamiens à Dien Ben Phu, qui marque la fin de la guerre d’Indochine. À bout de souffle se fait alors le témoin d’une génération emportée dans un vertige qu’elle ne maîtrise plus, oscillant entre la rêverie et l’envie de rien. Les jeunes japonais et français enchaînent cigarette sur cigarette, se laissent vivre et renoncent finalement à agir, vaincus par leur impuissance politique et sociale.

D’un côté, dans un quotidien parisien banal, Michel Poiccard se prend pour un héros romantique de film hollywoodien et tombe amoureux d’une étudiante américaine, de l’autre, Makoto et Kiyoshi sont représentatifs d’une jeunesse marginale, solitaire et désabusée au sein d’un Japon de plus en plus influencé par la culture américaine et fortement marqué par le souvenir de la Seconde Guerre mondiale et des bombes atomiques d’Hiroshima et Nagasaki.
C’est dans ce contexte que le cinéma devient un moyen d’expression et une prise directe avec le réel. Liberté technique, liberté esthétique, liberté du sujet et rupture avec un monde ancien et autoritaire, tels sont les mots d’ordre qui animent les deux jeunes cinéastes libres et audacieux. « À nouveau régime, nouveau cinéma », disait Chabrol. À la fin des années 1950, la Nouvelle Vague, en France comme au Japon, fait du cinéma le témoin de l’ancien monde qui s’écroule et le miroir d’une époque où la jeunesse lutte avec la même force qu’elle emploie pour rêver.