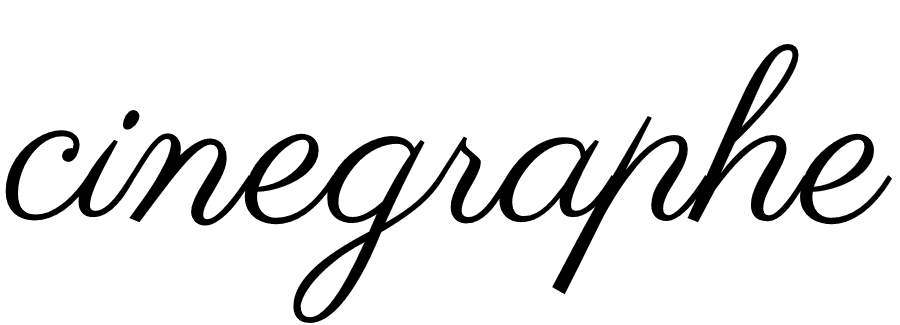Ni avec toi, ni sans toi
Telle est la formule qui clôt le film de François Truffaut, La femme d’à côté. Laconique, brève, averbale, elle en dit pourtant long sur la relation passionnelle présentée ici, entre Bernard Coudray (Gérard Depardieu) et Mathilde Bauchard (Fanny Ardant).
La légèreté amoureuse qui accompagne l’insouciance et la naïveté de l’enfance, portée notamment par le personnage d’Antoine Doinel — Antoine et Collette, Baisers volés, Domicile conjugal… – est ici congédiée pour laisser place à la lourdeur tragique d’un amour foudroyant et destructeur, déjà suggéré dans La peau douce (1964) et Le dernier métro (1980). L’amour se met à mort sur un ton grave, solennel et silencieux. Les actes impulsés par la passion devancent les mots qui finalement ne seront jamais prononcés. « Il fallait que je te parle », révèle Mathilde à Bernard à la fin du film, avant qu’il ne recouvre sa bouche de sa main puis de ses baisers. L’imparfait annonce à la fois une entreprise vaine, une raison impuissante, un regret à entendre comme « j’aurais dû te parler, nous aurions dû nous parler ». Mais la volonté ne peut vouloir en arrière et les deux amants, à force d’attendre et de différer leurs paroles en cédant constamment à leur désir, sont condamnés à une mort tragique.
Le film de Truffaut repose sur une intense vérité psychologique révélée par la peinture de l’amour-passion. L’amour est la passion tragique par excellence, comme chez Racine. Il est irrésistible et resurgit ici avec force chez les deux personnages qui se sont aimés quelques années auparavant. L’ironie tragique veut que Mathilde vienne habiter avec son mari dans la maison voisine de celle de Bernard et sa femme. Alors, par hasard, ils se retrouvent, longtemps après leur séparation. Mathilde, de dos, descend les escaliers, laissant d’abord paraître ses jambes, pour aller à la rencontre des nouveaux voisins. Elle ne le sait peut-être pas encore, mais cette descente lui sera fatale et annonce déjà sa lente déchéance morale et physique dans laquelle elle entraînera Bernard. L’échange de regards se fait dans un bref champ-contrechamp qui se concentre uniquement sur le visage de Mathilde, laissant Bernard de dos et flou. « Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue ; Un trouble s’éleva dans mon âme éperdue ». Ces vers de Racine, tirés de Phèdre, pourraient illustrer à merveille la réaction de Mathilde, dont le sourire s’efface peu à peu. Le regard se fait grave, l’amour surgit et se traduit par un désordre physiologique.

Le drame intérieur est lancé et rien ne pourra l’arrêter. La scène d’ouverture proleptique annonçait déjà la mort comme la seule issue de cette histoire. La musique à la cadence rapide de Georges Delerue accompagne le long travelling aérien suivant la voiture de police au travers des routes de la banlieue de Grenoble, donnant ainsi à l’histoire sa tonalité tragique d’enchaînement fatal. La passion ne peut être contenue à l’intérieur des personnages. Elle éclate dans des espaces clos qui les enferment dans une topographie précise où leur amour étouffant les lie : dans un parking de supermarché, où l’illusion que l’issue tragique pourra être évitée est vite anéantie par un baiser ardent, qui fait perdre connaissance à Mathilde sous le poids de sa première défaite dans la lutte acharnée contre la passion envahissante ; dans une chambre d’hôtel, lieu secret de leurs ébats amoureux, où l’aveu d’impuissance à résister au désir est vertigineux ; dans une voiture, où le plaisir succède aux larmes ; dans une maison vide, où l’amour triomphe dans le crime et le suicide, faisant du dénouement sanglant une nécessité dramatique et psychologique.
Le petit jeu de fuite ne pouvait plus durer. La folie gagne les personnages, présentés comme des êtres faibles en proie à une passion violente, les conduisant à perdre le contrôle de leur corps et de leur raison, chacun étant hanté par le spectre tentateur de l’autre.

Le romanesque surgit au sein de la tragédie. La narration fluide, le genre du conte, l’enchaînement rapide des actions et des scènes exigent une participation active du spectateur. Madame Jouve (Véronique Silver), qui apparaît dès le début du film dans un fondu enchaîné, se pose en narratrice-personnage de ce roman d’amour tragique. Regard caméra, elle en annonce l’issue fatale, donnant à l’histoire son temps et son lieu : « Il faisait encore nuit quand la voiture de police a quitté Grenoble ». La focalisation interne s’efface au profit d’une narration omnisciente et rétrospective. La caméra recule progressivement pour montrer que Madame Jouve porte à sa jambe une attelle et qu’elle se déplace en prenant appui sur une béquille. Plus tard, le spectateur apprend que ce sont là les marques d’un amour passé qu’elle ne pouvait plus supporter et qu’elle a échoué à fuir après avoir survécu à sa chute dans le vide. Figure maternelle, protectrice et bienveillante, Madame Jouve offre la possibilité de repousser la fatalité de la passion par la raison et le discernement. Elle invite Bernard à parler à Mathilde, lorsque celle-ci est internée dans une clinique psychiatrique, afin de « dépassionner tout ça », mais se doute qu’il est déjà trop tard, qu’elle ne pourra empêcher l’histoire de progresser inéluctablement vers sa fin.
Cette fin, c’est une scène d’amour violente et meurtrière, qui concilie deux esthétiques cinématographiques d’Hitchcock, cinéaste qui, selon Truffaut, « filme des scènes d’amour comme des scènes de meurtre et des scènes de meurtres comme des scènes d’amour ». Le travelling sur les jambes de Mathilde, marchant lentement la nuit autour de la maison avant la scène finale et dont le pas est rythmé par les violons de Delerue qui se font crescendo, son ombre sur le mur, les bruits sourds dans la pénombre, sont autant d’éléments qui ajoutent au genre tragique une dimension de film policier. Ce « film d’amour qui fait peur », pour reprendre la formule employée par Gérard Depardieu à propos de La femme d’à côté, se conclut dans l’excessive volupté de la passion tragique.

Tragédie classique, roman d’amour, tous les genres se mêlent. L’amour passionnel bouleverse un ordre social tranquille et intime. La représentation idyllique et harmonieuse de l’amour entre les personnages est définitivement abolie. Plus question pour le cinéaste d’en offrir une vision fantasmée, d’un point de vue qui occulte les souffrances à l’écran, les contenant pour ne les révéler qu’à la fin, toujours par la mort et le suicide, comme dans Jules et Jim (1961), où tout ce qu’il y a de tragique dans la passion est recouvert d’un voile léger qui laisse voir son côté badin et insouciant. Plus question non plus de montrer les deux faces de ce sentiment qui parfois sont conciliables, comme dans La sirène du Mississippi ou Le dernier métro, où l’amour est à la fois « une joie et une souffrance ». Avec La femme d’à côté, la joie appartient au passé, un passé heureux que les personnages veulent à tout prix faire renaître.

La souffrance règne et guide l’histoire. Cette souffrance, c’est celle que Mathilde entend dans les chansons, « parce qu’elles disent la vérité (…). Elles disent ne me quitte pas, ou ton absence a brisé ma vie, ou je suis une maison vide sans toi (…) ».
La vérité de la passion est présentée simplement, sans artifice, pour frapper violemment le spectateur, qui trouve néanmoins une once relative d’espoir dans l’apaisement intérieur de Madame Jouve. L’amour est donc un risque à courir, mais le film semble vouloir nous dire qu’il faut toujours garder à l’esprit que « les histoires d’amour doivent avoir un début, un milieu et une fin ».