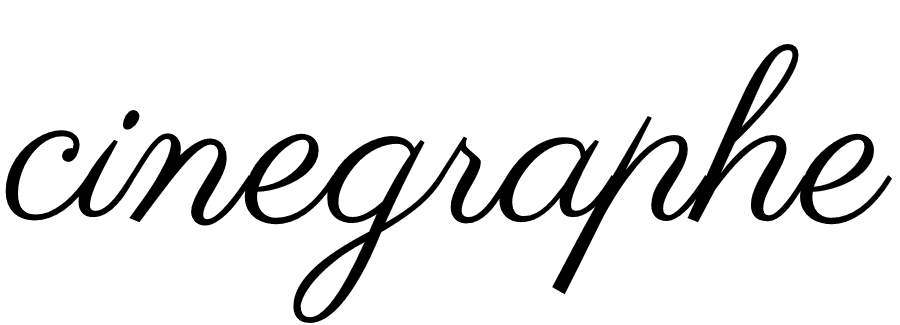Il étaient des nouveaux-nés, quelqu’un, quelqu’autre, quelques uns.
Une femme se cache parmi les réalisateurs, scénaristes, acteurs et autres personnalités et figures essentiellement masculines qui peuplent le cinéma français de la fin des années 1950, peu de temps avant le début de la Nouvelle Vague. Cette femme, c’est Agnès Varda, photographe, réalisatrice, scénariste, née dans l’entre deux-guerres et morte cette année, à l’âge de 90 ans.
Si Varda n’a jamais fréquenté la rédaction des Cahiers du cinéma, à la différence des jeunes turcs — Truffaut, Godard, Rivette, Chabrol — qui étaient ses contemporains, elle était dans les années 1960 une représentante du jeune cinéma français. Son travail s’inscrit dans une entreprise de libération formelle du septième art, en explorant de nouvelles formes d’expression visuelle et affirmant une modernité et une liberté toutes deux portées par la jeunesse.
En 1958, elle réalise L’Opéra-Mouffe, son deuxième court-métrage, présenté ainsi par le premier intertitre : « Carnet de notes filmées rue Mouffetard à Paris par une femme enceinte en 1958 ». Cette femme enceinte, c’est Agnès Varda, qui s’expose, nue, et laisse le spectateur se rapprocher de son ventre gonflé, dans lequel respire la vie nouvelle. C’est à ce moment-là que surgit la musique enjouée et rythmée de Georges Delerue, grand compagnon musical de la Nouvelle Vague.
Le film, s’il appartient plutôt au genre du cinéma expérimental, porte en lui les prémices de la Nouvelle Vague. Varda filme la rue Mouffetard, aussi connue comme « la Mouffe », ce quartier où le désordre fait régner une effervescence portée par chaque habitant et chaque commerçant. Aussi les scènes sont saisies presque à la sauvette, laissant voir des impressions, des réactions, des expressions qui viennent se fixer sur l’image et s’insérer dans cette galerie de portraits. Varda s’intéresse à tout ce petit monde désordonné : les amoureux, les ivrognes, les clochards, les gamins de Paris, les vieilles dames et les commerçants gouailleurs. Les enfants s’amusent à porter des masques et à se courir après, dans un carnaval faisant de la rue la scène de leur commedia dell’arte. « Ils étaient des nouveaux-nés, quelqu’un, quelqu’autre, quelques uns », chante Varda en ouverture de l’épisode intitulé « Quelques uns ». Sa caméra se pose sur eux et les extirpe de leur anonymat. Le flou de la foule devient visible, il laisse apparaître des figures vivantes, heureuses, tristes, pressées, bavardes, silencieuses. Les visages se succèdent au rythme de la musique de Delerue, qui souligne l’urgence du passage, le fouillis de cette rue, le flot de paroles des passants, et la rapidité du mouvement. Varda saisit des mimiques, des comportements, des gestes et des regards qui sont propres aux parisiens de la Mouffe, ces gens pauvres tout droit sortis de L’Opéra de quatr’sous de Brecht.

Les voilà donc qui titubent ou déambulent parmi les étalages, sur lesquels la nourriture est exhibée sans mesure : les poissons regardent d’un air livide les légumes entassés, les gibiers sont pendus au dessus des viandes exposées au regard des passants affamés, une femme mange un bouquet de fleurs. Varda mêle les prises de vues, joue sur le mouvement et la fixité, permettant ainsi de rendre compte au maximum de la profusion des denrées et l’agitation des foules, qui rappellent en ce sens celles des Halles au siècle précédent, ce « Ventre de Paris », comme l’a écrit Zola.
Mais il y a aussi un autre ventre, celui de la réalisatrice enceinte, qui exprime ses peurs. Varda montre son ventre gonflé, et le plan qui lui succède présente un chou que l’on coupe en deux. « Les enfants naissent dans les choux », dit-on. Mais ici la transition est violente, les morceaux de choux coupés sont filmés un à un, immobiles. Ce corps en état de métamorphose fait du cercle un motif récurrent dans le film : le ventre, les choux, mais aussi les nervures d’une planche de bois, un vase cylindrique dans lequel se trouve une colombe, ou encore des citrons, qui sont comme des natures mortes qui s’enchaînent. La réalisatrice offre ainsi un poème imagé et métaphorique sur la grossesse, comme expérience vécue et s’insérant dans un présent précaire et fugace.
Malgré ses craintes, Varda donne à son court-métrage une touche de légèreté lorsqu’elle filme des amoureux qui s’enlacent, dans un appartement étroit et miteux, mais qui semble suffire à leur bonheur. L’image devient picturale, et les corps s’animent en des tableaux vivants. Le dos de la femme derrière la tête de lit rappelle la photographie de Man Ray, Le Violon d’Ingres. La voici ensuite en Olympia, de dos, moderne et insouciante, allongée nue sur un lit au beau milieu de la cour intérieure.

La poétique des corps s’associe ainsi à celle de la rue, et toutes deux rendent compte d’une réalité contemporaine à la réalisatrice, de ses craintes et de ses envies. L’Opéra-Mouffe est une oeuvre chantée, un poème subjectif qui touche tout un monde où la noblesse des petites gens est révélée par le regard d’Agnès Varda.